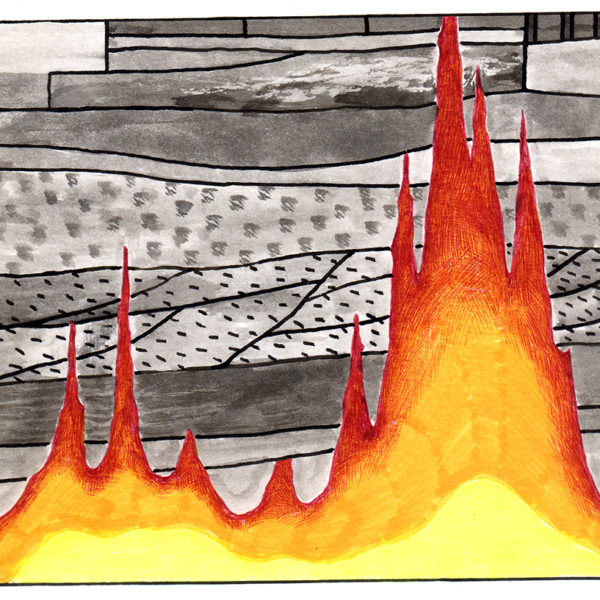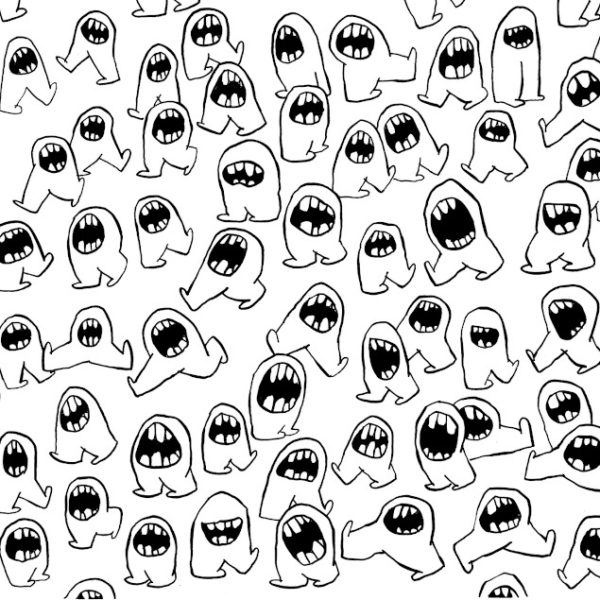Cela fait plus de dix ans que le monde du soin psychiatrique en France est entré en résistance contre le programme de contrôle de la folie que les personnes en lutte qualifient de « nuit sécuritaire ». Ce tournant idéologique, initié par un discours de Nicolas Sarkozy fin 2008 prêchant les soins sous contrainte, s’est appuyé par la suite sur une profonde réorganisation du travail en hôpital : politique d’austérité budgétaire, introduction de techniques de management et de démarches « qualité », etc. Si bien que des collectifs de soignant·es – comme Les perchés du Havre, Pinel en lutte ou Les Blouses noires – se joignent à présent aux patient⋅es pour crier leur écœurement devant le retour des pratiques les plus inhumaines de l’univers asilaire.
Partout en France, soignant·es et patient⋅es alertent sur la situation dramatique des hôpitaux psychiatriques, malades des conséquences des politiques d’austérité budgétaire imposées par les agences régionales de santé et les directeurs et directrices d’hôpitaux : fermetures de lits (de 100 000 lits dans les années 1970, on est passé à 57 000 en 2015), mutualisations d’établissements ou mesures de réduction du personnel médical font qu’anxiolytiques et neuroleptiques à haute dose remplacent peu à peu le travail d’écoute des soignant·es. Alors que les dotations financières des agences régionales de santé à destination des hôpitaux croissent de 2 à 3 % par an, celles des services psychiatriques n’ont augmenté que de 0,88 % au cours des quatre dernières années.
Au gré des regroupements hospitaliers, les directeurs et directrices d’hôpitaux sabrent dans les effectifs. Moins nombreux⋅ses, les soignant⋅es se retrouvent de plus en plus souvent dos au mur face à l’urgence : alors qu’on les croyait datant d’une époque révolue, l’enfermement et la camisole, devenue chimique, font leur retour dans les services psychiatriques. Quand un·e seul·e soignant·e doit s’occuper d’une trentaine de patient·es, pas le temps de discuter, de prendre le pouls des situations des un·es des autres pour établir un diagnostic juste. Le nouvel « hôpital-entreprise s’appuie sur les neurosciences et leurs grilles d’évaluation contre la psychanalyse et les acquis d’une psychiatrie relationnelle et du sujet », écrit Jean-Pierre Martin, clinicien, dans son livre Émancipation de la psychiatrie (Syllepse, 2019). Au nom du virage ambulatoire, les temps de séjours sont réduits : le temps de traiter les crises les plus graves avec l’armoire à pharmacie puis les patient⋅es sont renvoyé⋅es dans leur vie de tous les jours, gavé⋅es de psychotropes censés leur rendre leur conformité sociale au plus vite.
En outre, les moyens enlevés aux hôpitaux, lorsqu’ils sont réorientés vers les structures extra-hospitalières comme les centres médico-psychologiques (CMP) ne suffisent pas, et l’accompagnement de tous les jours est sous-traité aux associations, à la sphère privée. « On nous demande d’hospitaliser moins de jours, on connaît moins bien les gens qu’avant, on n’a plus le temps de les aider dans leur quotidien. Aux urgences psychiatriques, on est forcé⋅es de refuser du monde, alors que la vie de certains et certaines est peut-être en danger. Et si quelqu’un se suicide juste parce qu’on n’a pas eu de lit disponible pour l’accueillir ? », raconte Ariane, infirmière dans un hôpital psychiatrique du XIXe arrondissement de Paris et membre du collectif Psychiatrie parisienne unifiée. Le délitement de l’hôpital public, désormais géré selon une logique de rentabilité, précarise encore plus les patient⋅es les plus vulnérables. Dans la capitale comme ailleurs, l’agence régionale de santé souhaite développer le recours aux cliniques privées en supprimant des lits dans le public et en fusionnant trois hôpitaux psychiatriques (Maison Blanche, Saint-Anne et Perray-Vaucluse) en un seul groupe public de santé. L’hôpital-entreprise impose aux infirmier·es de devenir managers de lits, « une dynamique aggravée par le retour généralisé à un enfermement sécuritaire des patient·es et des soignant·es ».

L’enfermement prend le pas sur le soin
« Bien sûr, en tant que soignante, je peux comprendre que la contrainte physique et la chambre d’isolement paraissent parfois nécessaires. Si un·e patient⋅e est trop agité·e, une injection de Clopixol semi-retard et il ou elle dort trois jours. », raconte Julie, une ancienne infirmière. « Mais trop souvent, la contrainte est utilisée à tort. » Après avoir injecté des grammes et des grammes de Clopixol, elle a reçu à son tour ces mêmes injections, lorsqu’elle a commencé à souffrir de schizophrénie. Elle se rappelle les neuroleptiques qui « zombifient et vident le corps » et les deux mois passés en chambre d’isolement, une durée beaucoup trop longue, même par rapport aux recommandations de la Haute autorité de santé. « Une vraie torture. À part ressasser ses problèmes, il n’y a absolument rien à faire. Certain⋅es médecins appellent ça de l’hypostimulation, pour moi c’est juste de la privation sensorielle : on m’a même confisqué mes livres. », poursuit-elle. Comme l’explique Marie, une salariée de l’hôpital psychiatrique de Rouen et membre des Blouses noires, la multiplication de ces mesures sécuritaires ces dernières années, en raison du « manque de soignant·es qui engendre un recours beaucoup trop important à la chambre protégée et à la contention », augmente le risque de réaction violente des patient⋅es, d’automutilation ou de délire défensif. « Ça a alimenté mon ressentiment, ma révolte et ma rage, se rappelle Stéphane, bipolaire depuis ses 20 ans et habitué des services psychiatriques, de Montpellier à Caen. Chaque retour à l’hôpital provoquait des colères chez moi, qui n’auraient peut-être pas eu lieu si la prise en charge lors de mes premières hospitalisations avait été meilleure. À chaque fois que je retourne à l’HP, c’est la même punition, le même traitement : les pompiers me font rentrer de force dans le camion, et je me réveille le matin en chambre d’isolement, parfois une pièce vide avec un matelas en caoutchouc, le corps entravé par les sangles. C’est aberrant, à quoi bon ? » Tous ces témoignages vont dans le même sens : à quoi bon entrer dans un hôpital psychiatrique si c’est pour en ressortir avec la rage au cœur ? Pour Jean-Pierre Martin, « l’intrusion d’une politique sécuritaire et ses gouvernances d’enfermement généralise la dangerosité à tous les patients ».
« En tout, j’ai dû passer deux ans entre les murs, et j’utilise ce mot car je le vis à chaque fois comme un emprisonnement. On sait quand on y entre mais pas quand on en sort : c’est un peu l’arbitraire psychiatrique », raconte l’ancien professeur, de sa voix calme, qui s’emballe parfois. « À Montpellier, après que mes amis ont remarqué mes changements de comportement brusques, j’ai été hospitalisé de force. J’ai été mis à l’isolement, attaché à un lit pendant trois jours. Je ne pouvais pas atteindre la sonnette d’appel, je me suis pissé dessus, je suppliais l’infirmier de me détacher, sans résultat. » Difficile de voir un·e médecin ou infirmier·e quand on est interné⋅e en hôpital psychiatrique, hormis lors de la sacro-sainte prise des cachets, une ou deux fois par jour. Le reste du temps, les personnels sont accaparés par leur travail administratif, la saisie informatique d’actes de soins répertoriés par des grilles d’évaluation qui standardisent l’analyse des symptômes en fonction des traitements médicamenteux (classification DSMV, d’origine étatsunienne). Le travail des soignant⋅es doit pouvoir être économiquement évaluable, afin d’être rationalisé et rentabilisé. Aux yeux des nouveaux et nouvelles managers hospitalier⋅es, le dialogue avec les patient·es coûte trop cher et ne produit pas de résultat évaluable dans l’instant. Exit donc l’empathie. D’un coup de pharmacologie sont balayés les progrès phénoménologiques et psychanalytiques qu’a pu accomplir la psychiatrie dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec Tosquelles, Oury et Guattari, et d’autres clinicien·nes militant·es de l’après-guerre. Sans médicaments, ces pionnier⋅es n’auraient sans doute pas pu intégrer leurs patient⋅es dans des pratiques autogestionnaires, mais les pilules et les injections seules ne sont sûrement pas la solution, sauf à vouloir rendre dociles des personnalités fragmentées et imprévisibles.
« Le psychiatre, je le voyais une fois par semaine pendant quinze minutes pour régler mes doses de neuroleptiques. Plus j’essayais d’évoquer mes angoisses avec lui, plus il augmentait mes doses. Je me suis rarement sentie écoutée. J’étais tellement shootée par les médocs que je ne contrôlais plus ma mâchoire, je me bavais dessus. Quand je me regardais dans le miroir, je m’effrayais moi-même. » Irène a été hospitalisée suite à des délires psychotiques de persécution qui l’ont poussée à fuir le domicile familial pour aller se réfugier dans les contreforts montagneux des Alpes durant quelques jours. Après trois mois d’hospitalisation, elle sort sans vraiment être fixée sur sa pathologie et consulte aujourd’hui un psychiatre en libéral. Mais elle ne lui avoue pas tout, de peur d’être renvoyée de force à l’hôpital, pour cause de péril imminent. La solution de l’hospitalisation, parfois sous contrainte, semble être souvent privilégiée par les psychiatres, peut-être car les centres médico-psychologiques ne sont pas assez nombreux et trop inégalement répartis sur le territoire. Ou que de récentes lois sécuritaires facilitent les obligations de soins. D’une main l’État enferme de plus en plus de personnes présumées folles, et de l’autre il ferme de plus en plus de lits. Quelle logique déceler dans ce paradoxe ? « Dans les années 1970, il y a eu un courant antipsychiatrique qui prônait la fin de l’hôpital psychiatrique, les soins dans la ville. Mais on s’est bien fait arnaquer : le nombre de lits a été réduit et derrière, il n’y a pas eu de création de structures intermédiaires pour compenser. », analyse Julie. Les politiques de sectorisation, lancées il y a une quarantaine d’années, ambitionnaient en effet de tisser tout un réseau d’institutions et d’associations encadrant les malades à leur sortie de l’hôpital. En maillant les villes de structures intermédiaires comme les centres médico-psychologiques et les hôpitaux de jour, administrateur, administratrices et psychiatres espéraient sortir l’hôpital psychiatrique de son vieux fonctionnement asilaire et de ses tentations totalitaires pour développer une médecine communautaire, reposant sur toute une série de nouveaux acteurs et actrices, des ergothérapeutes aux psychomotricien·nes. Une réflexion sur la folie, inscrite dans son contexte géographique et social. De cet idéal, les gestionnaires n’ont finalement gardé au cours des années qu’une politique de fermeture de lits, sans financer ces structures alternatives. Et les personnes en détresse psychique n’ont souvent d’autre choix que se rendre aux urgences psychiatriques, débordées.
Carol, une jeune informaticienne, se rappelle de son arrivée volontaire au centre psychiatrique d’orientation et d’accueil de l’hôpital Sainte-Anne à Paris, après une longue dépression et des envies suicidaires : « En hospitalisation libre, on peut théoriquement partir quand on veut, mais ça ne s’est pas passé comme ça pour moi. On m’a pris mon téléphone de force, forcée à me mettre en pyjama, mis mes affaires dans un placard sous clé, menacée d’une hospitalisation forcée. On m’a dit que c’était le règlement. Personne ne m’avait prévenue que ça se passerait comme ça. Puis j’ai finalement eu une permission un week-end et quand je suis revenue, ils avaient donné mon lit à un autre patient. J’ai décidé de me barrer, je voulais prévenir les infirmières, mais elles étaient débordées, j’ai attendu trois heures et je suis partie. » Depuis, la jeune femme est prise en étau entre l’hôpital où elle ne souhaite pas retourner et le manque de structures de soins par ailleurs. Dans ces conditions, difficile pour elle de bénéficier d’un suivi médical sur le long terme, d’autant plus qu’elle non plus n’ose pas parler à son psychiatre de ses pensées suicidaires, de peur d’être renvoyée à l’hôpital. Même en hospitalisation libre, les violences psychiatriques ne sont jamais bien loin.
« Les patient·es qui restent plus longtemps, ce sont celles et ceux qui ont été hospitalisé·es de force. », constate Auriane, l’infirmière qui se bat pour réhumaniser la psychiatrie au sein du collectif Psychiatrie parisienne unifiée. Les autres peinent à accéder aux soins et se retrouvent souvent livré·es à elleux-mêmes, alors même que notre société néolibérale et compétitive produit de plus en plus de précaires, de paumé·es et et de jeunes déboussolé·es, victimes de nouvelles pathologies.