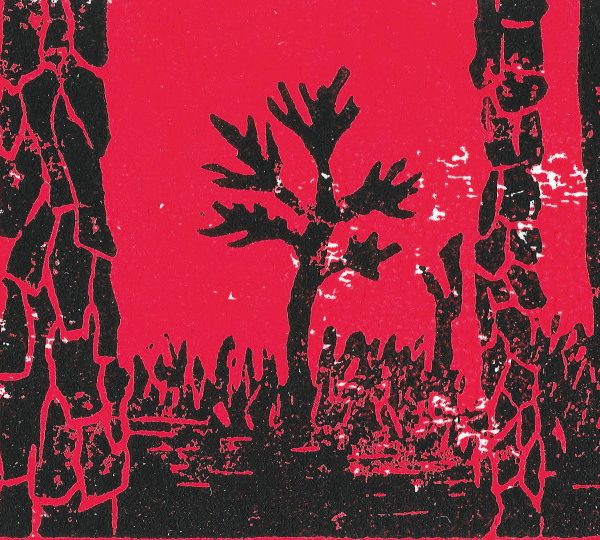Photographies par Ahmad Ebrahimi
Ouvert en 2013 sur l’île de Lesbos en Grèce sur le site d’une ancienne base militaire, le camp de Moria accueille et retient les réfugié·es qui cherchent à rejoindre l’Europe. L’un des cinq centres d’enregistrement et de contrôle situés en mer Egée, il se double d’un centre de détention, témoignant d’une gestion sécuritaire et d’une criminalisation de ces migrations. Coercition, détention arbitraire, expulsions, refoulements massifs et violations des droits fondamentaux sont au rendez-vous. Prévu pour loger 3 000 personnes, on dénombre en janvier 2020 plus de 20 000 personnes vivant à l’intérieur du camp et à ses abords.
En septembre 2018, Clément Aadli, Adrien Chevrier et Amélie Perrot mettent en place des ateliers de radio hébergés dans un accueil de jour situé en marge du camp. Emportant des enregistreurs avec elles et eux, les participant·es des ateliers racontent, interviewent d’autres habitant·es, captent la vie du camp et inventent leur radio. Retour en deux parties sur cette expérience radiophonique à l’heure où la crise du coronavirus et le défaut de protection sanitaire vulnérabilisent encore davantage les réfugié·es de Moria.
Écouter trois émissions musicales de Radio, Lesbos.
Farouk : Bonjour à tous. Aujourd’hui, ce sont nos vies que nous voulons amener jusqu’à vous. Nos vies dans le camp de Moria. Nous voulons vous raconter à quoi elles ressemblent. Et nous commencerons en parlant de notre arrivée ici, à Lesbos, en Grèce.
La pièce où se sont déroulées ces émissions de radio était une cabane en bois, sur l’île grecque de Lesbos, aux confins de la partie orientale de la mer Méditerranée, aux frontières de l’Europe. Par la porte laissée ouverte, nous voyions la mer, et les côtes turques, en face, à quelques kilomètres. Toutes celles et ceux qui participaient aux émissions vivaient dans le camp de réfugié·es de Moria. Sauf l’un d’entre elles et eux, dont nous avons appris plus tard qu’il en avait été évacué après avoir failli y mourir de trois coups de couteaux.
Sahar Mousavi est l’une des premières à avoir pris la parole pour parler du camp. Elle est venue d’Afghanistan avec son mari et sa fille de quatre ans.
Sahar Mousavi : Quand je suis arrivée, il y a trois mois, j’étais très triste et je me disais que je n’avais aucune chance dans la vie, que pour moi tout serait toujours difficile et je ne comprenais pas pourquoi. Je vais un peu mieux maintenant. Avec ma fille et mon mari, nous vivons avec deux autres familles dans un container. Ce n’est plus aussi dur qu’à notre arrivée.
Les premiers jours, c’était très difficile et très sale, surtout pour les enfants. J’ai été vraiment choquée en découvrant la saleté de cet endroit. Ma fille dormait par terre, au milieu des déchets.
Et moi, je pleurais. J’ai pleuré pendant des nuits. Quand je pleurais, je pensais à mon avenir et à celui de ma fille. C’était très dur. Je ne veux pas me souvenir de tout ça.

Il était impossible d’organiser des ateliers de radio à l’intérieur de Moria. L’accès est interdit aux associations non autorisées, c’est à dire presque toutes. Il est interdit de filmer le camp, d’y prendre des photos et d’y enregistrer. Un grand panneau le rappelle à l’entrée. À trois reprises en 2018 et 2019, nous avons donc installé la radio dans un accueil de jour, à une heure à pied du camp. Abri provisoire surplombant la mer. Ici, le vent souffle souvent fort.
Au moment où nous écrivons, nous ne savons pas si cet endroit pourra un jour accueillir et aider des réfugiés à nouveau. Cet accueil de jour s’appelle OHF. Il vient d’être dévasté par le feu. L’incendie est très probablement criminel. Depuis cinq ans, réfugié·es et bénévoles tentaient patiemment d’y construire et d’y apporter ce dont les réfugié·es manquent à Moria. C’est-à-dire à peu près tout : un lieu où se retrouver en sécurité, un repas par jour, des consultations de médecin·es et d’avocat·es, une école, des livres, une prise pour recharger son téléphone, quelques activités sportives, culturelles et éducatives. Le centre abritait également un espace réservé aux femmes, un potager, un petit atelier de réparations. Nous regardons les photos qui nous parviennent, cherchant ce qui subsiste après le feu. L’école, au premier plan, à droite en entrant dans le centre, a été entièrement détruite.
Ce n’est pas le premier incendie qui frappe une ONG de l’île ces dernières semaines. Lesbos ne tient plus. Et pourtant, l’île ne tenait déjà plus quand ces émissions de radio y ont été enregistrées, l’année dernière.
Farouk : Mon premier jour ici… J’étais épuisé. C’était très stressant. Je n’avais jamais rien connu de tel auparavant. Au Ghana je tenais un magasin, j’avais ma propre affaire. Pour la première fois, je me retrouvais dans un camp. Vous savez, je suis arrivé très tôt le matin, nous n’avions rien à manger ou à boire. Le voyage avait commencé la veille au soir, et toute la journée nous avons attendu à Moria sans eau ni nourriture. Le soir on nous a seulement donné un morceau de pain et une petite bouteille d’eau. Mon esprit était totalement confus. Je me disais que si c’était ça la vie que je m’apprêtais à vivre à Moria, j’allais devenir fou. Mes pensées commençaient à tourner. Et puis j’ai fini par rencontrer des gens qui vivaient déjà ici. Aujourd’hui, je me dis que peut-être, un jour, ma vie changera. Et je remercie tout de même Dieu. Car si je n’étais pas venu à Moria, je n’aurais pas rencontré ma femme. Ça a été quelque chose de fort pour moi.
Mais je ne crois pas que je suggérerais à quiconque de venir ici, à cause de la vie qu’on mène dans le camp. J’aurais aimé que ce soit une meilleure expérience pour tout le monde. Qu’en étant ici, on découvre aussi comment d’autres vivent ailleurs dans le monde. Mais je ne crois pas qu’ici soit un meilleur endroit où vivre pour qui que ce soit.
Selon les jours, les mois, les voix réunies autour des micros étaient celles de Farouk, Alain Serge Soh, Anoosh Ariamehr, Ahmad Ebrahimi, Sahar Mousavi, Giscard, Hadi, Sarah, Mehdad, Zahra, Ali Mousavi, Ali Nuri. Certain·es ont voulu donner leurs noms de famille, d’autres non. La plupart d’entre elles et eux faisaient de la radio pour la première fois.
Chaque atelier de radio consistait à enregistrer une émission. En général, entre quatre et huit personnes venaient discuter autour des micros et réfléchir à ce qu’elles voulaient faire entendre. Nous ne posions aucune question et n’intervenions pas pendant les émissions. Les participant·es décidaient ensemble de ce dont ils et elles voulaient parler, et étaient tour à tour et tous·tes à la fois journalistes et invité·es, intervieweur·ses et interviewé·es. Entre les ateliers, nous leur prêtions des enregistreurs en leur proposant de faire entendre leurs vies dans le camp et ailleurs sur l’île : la fermeture éclair d’une tente qui s’ouvre pour traverser le camp dans l’agitation du soir, la cohue des files d’attente, la mélancolie d’une chorale d’enfants, la « voix » de Moria à minuit, la désolation d’une guitare. Certain·es enregistraient aussi avec leurs téléphones. Ils et elles improvisaient parfois des jingles ou des musiques. Plusieurs fois, certain·es ont apporté des instruments de musique pour accompagner ou ménager des transitions dans l’émission. La toute première s’appelait « Moria Focus ». Et la dernière : « Radio Azaadi », qui signifie, en farsi : « Radio liberté ».
Avant l’évolution des politiques migratoires européennes, l’île de Lesbos n’était pour les réfugié·es qu’un lieu de passage. Il est tristement ironique de se souvenir qu’en 2013, Moria ne prévoyait d’accueillir qu’une centaine de personnes pour une ou deux nuits avant leur transfert vers Athènes. En septembre 2015, le camp est devenu le tout premier « hotspot » de l’Union Européenne. Moria est désormais un centre de tri et d’enregistrement. Le camp est gardé par la police et l’armée. Il est bordé de champs d’oliviers et de propriétés solidement clôturées. À l’intérieur du camp se trouve une prison.
Au moins 10 000 personnes lorsque nous y étions, et 20 000 personnes aujourd’hui, vivent à Moria, partageant un container avec une ou plusieurs autres familles à l’intérieur du camp, ou une tente siglée HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés) et marquée d’un numéro à l’extérieur du camp. Certain·es n’ont, pour s’abriter, que de petites tentes individuelles. Car depuis longtemps le camp déborde, entre les oliviers, dans la boue quand il pleut, sur le gel du sol et des pierres quand gèlent les pierres l’hiver, la nuit. D’un hiver à l’autre depuis les années misérables que dure l’horreur du camp, plusieurs personnes sont mortes étouffées par les relents empoisonnés de leurs chauffages improvisés. 20 000 personnes vivent là, dans un camp dont la capacité d’accueil est d’à peine 2 500 personnes. Elles viennent d’Afghanistan, du Cameroun, de Syrie, d’Irak, du Congo, d’Iran, et de dizaines d’autres pays.
Pour avoir le droit de quitter l’île, il faut obtenir sur sa carte de réfugié un tampon bleu. La procédure, depuis le premier interrogatoire (« interview d’admission ») jusqu’à l’obtention du fameux tampon prend des mois, parfois des années. Après avoir reçu ce tampon bleu, les réfugiés doivent encore attendre l’entretien qui statuera sur l’octroi ou non du droit d’asile.

Ces émissions de radio ont été enregistrées avant l’arrivée au pouvoir à Athènes d’un gouvernement conservateur. Les autorités grecques ne construisaient pas encore sur l’île des camps fermés. Elles ne réprimaient pas encore avec violence les manifestations de réfugié·es. Les bâtiments et les véhicules des ONG n’étaient pas encore incendiés. On ne voyait pas d’habitant·es de l’île repousser les embarcations vers la mer. Aucune vidéo ne montrait encore des gardes-côtes grecs tenter de percer un canot pneumatique ou tirer autour d’un bateau pour effrayer des hommes et des femmes qui fuient les horreurs de la guerre.
Mais l’Europe abandonnait déjà les îles de la mer Egée et celles et ceux qui atteignent ses côtes. Tout, dans les témoignages racontés autour des micros, disait déjà une volonté européenne d’entretenir la misère.
Farouk : Sarah, qu’est-ce que tu vois à l’intérieur du camp de Moria ? Pas seulement en arrivant, mais en y vivant ? Comment te sens-tu dans ce camp et plus généralement ici en Grèce ?
Sarah : Quand je suis arrivée, il y a trois semaines, nous avons passé une semaine sous un arbre. Personne ne vient vers vous pour vous poser des questions, savoir si vous avez un endroit où dormir. En arrivant au camp, nous devions chercher nous-mêmes cet endroit. Quand on arrive, on est déjà assez abattu·es. On a pris des risques… Je suis assise ici, et je vois par la porte toute cette eau que j’ai dû traverser. J’ai risqué ma vie pour fuir des conditions déplorables. Là où je vivais avant, il n’y a pas de boulot, pas même de quoi manger. J’ai fui pour venir chercher mieux que ce que j’ai laissé derrière moi. Je ne m’attendais pas à tomber dans un camp et à être traitée de cette manière.
Moria, vraiment, si je parle avec mon cœur et avec mon esprit, je crois que je vais me mettre à pleurer. Il y a une insécurité totale. Pour un rien, les gens se mettent à se bagarrer, à se taper dessus. Les gens se blessent. Tu n’es même pas concerné·e par la bagarre, et quelque chose peut te tomber dessus, ou bien on te frappe en passant. On détruit les tentes alors qu’il n’y en n’a déjà pas assez. Pour manger on nous donne du poulet pourri. C’est surpeuplé. Sahar parlait de l’insalubrité. Elle disait qu’elle allait peut-être partir, aller ailleurs. Bon, aller ailleurs : mais comment ? La procédure, seulement pour avoir le tampon bleu et aller à Athènes met du temps. Sahar est là depuis trois mois. Pourquoi autant de temps ? Alors que les gens arrivent tous les jours. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps ? Est-ce que les… Comment on appelle ça ? L’État, les gouvernements, ne voient pas ces cris de détresse ? Parce que quand les gens arrivent chaque jour, ça veut dire que là où ils sont ça ne va pas. Là où ils sont, ils souffrent. Là où ils sont, ils ont besoin d’aide. Maintenant, nous sommes ici en Grèce. Qu’est-ce qu’il faut faire ? Est-ce que c’est de nous contenir dans ce lieu qui va améliorer la situation ? Il y en a qui ont fait un peu d’études, il y en a qui savent se débrouiller avec leurs mains. Donnez-leur l’opportunité d’aller chercher un petit boulot à Athènes, peut-être de continuer leur route. Ici il y a une insécurité pas possible. Les vêtements… Nous, on vient par exemple avec un seul vêtement sur nous, et on nous en donne un autre. Vous passez trois mois sur place avec deux vêtements, c’est pas possible, ce sont des conditions inhumaines.
L’image qu’on nous donne de l’Europe, c’est qu’ici tout est à sa place, et que l’humain est au centre de tout. L’humain est à l’avant, même, de tout. Mais pourquoi est-ce qu’on ne nous traite pas comme des humains ? Ce n’est pas normal, je crois. L’humain est au centre de tout. Du moins c’est ce qu’ils nous font croire. Pourquoi est-ce qu’on ne nous traite pas comme des humains, tous ici réunis ?

Chaque jour, le studio de radio était monté puis démonté. Entre chaque atelier la radio continuait à exister à travers les téléphones et les enregistreurs.
Autour des micros, les participant·es se racontaient, et espéraient raconter à d’autres, les naufrages à quelques mètres des côtes, les enfants qui disparaissent en mer et que l’on ne peut aller chercher au risque de faire chavirer un bateau trop chargé. Et ce sont surtout les horreurs de Moria, ici, en Europe, dont ils et elles voulaient témoigner. Les hommes et les femmes qui dorment par terre, les maladies et l’absence de soin, la violence que produit l’indignité, la honte, l’attente, l’attente.
Un jour où Alain Serge Soh – qui participait à tous les ateliers de radio – évoquait la question de la langue et des difficultés à communiquer dans le camp de Moria, un mot lui est venu spontanément. C’est un mot grec : « Perimene », « Attends ». Attendre des heures pour prendre une douche ou aller aux toilettes, des semaines pour voir un·e médecin·e, un·e avocat·e ou pour obtenir une date de rendez-vous avec les services d’asile. Attendre des mois ou pour certains des années l’autorisation de prendre le ferry pour Athènes, et attendre encore pour aller peut-être ailleurs en Europe. Attendre chaque jour, parfois jusqu’à dix heures par jour, pour une bouteille d’eau et un peu de nourriture.
Alain Serge Soh : Quand le bateau atteint la rive, tout le monde s’écrie : oui ! C’est l’Europe ! Le premier jour, tu es tellement joyeux d’arriver… Et puis, au bout de quatre jours, tu te dis « mon Dieu »… (riant).
Anoosh Ariamehr (riant, lui aussi) : C’est ça, l’Europe ?
Alain Serge Soh : Tu t’effondres… Le premier jour, dès le matin, tu dois faire la queue pendant deux heures pour un croissant et une bouteille d’eau… Tu te demandes quel est le problème… Et puis, à deux heures, quand tu veux récupérer un peu de nourriture… File d’attente… Les gens poussent : « Eh ! l’ami, dégage, dégage ! ». Tu te demandes : « Quelle langue parle cet homme ? ». Ça tourne dans ta tête, ça tourne dans ta tête. Après un mois, tout s’est effondré… Tu as perdu toute ton énergie, les connections ont disparu… Tout a disparu. Tu veux voir le docteur, file d’attente. Toujours des files d’attente. Toujours des effondrements. Toujours des problèmes. Tu veux prendre une douche… File d’attente. Problèmes. File d’attente…
Anoosh Ariamehr : Médecin… File d’attente. Service d’asile… File d’attente…
Alain Serge Soh : Toilettes… File d’attente. Moria… File d’attente. Encore une fois, tout est très difficile, mais si je peux dire quelque chose pour tout le monde : quand tu arrives, ce n’est pas le paradis, mais tu dois utiliser ta tête et rester fort. Parce que si tu ne restes pas fort, tu peux te suicider… Si je peux le dire ainsi…
Le camp de Moria distribue de la nourriture et de l’eau trois fois par jour. Une file d’attente immense, la « foodline », dure des heures et des heures. De nombreuses personnes disent être tombées malades après seulement quelques jours à manger la nourriture du camp. « Après une semaine, j’ai eu l’impression que mon corps se laissait mourir », nous a raconté un jour un homme venu du Libéria, « je n’ai pas mangé du tout pendant dix jours, et je me suis senti mieux. J’ai senti que mon corps recommençait à répondre ».
La faim, la soif, et les tensions qu’elles engendrent : des bagarres éclatent régulièrement dans la foodline, parce qu’une personne en a dépassé une autre, en a bousculé une autre. Une jeune femme arrivée un matin à l’atelier avec un imposant bandage autour de la main avait dit s’être faite mordre par une autre femme en essayant d’obtenir de l’eau.
De nombreuses tentatives ont été avancées pour améliorer le système de distribution de nourriture à Moria : mettre en place des tickets de rationnement valables pour plusieurs repas consécutifs, ouvrir les guichets de distribution de nourriture plus longtemps durant la journée, multiplier les points de distribution dans le camp, faire appel à d’autres entreprises et d’autres fournisseurs pour les différents repas, etc. Toutes ces propositions et toutes les tentatives qu’elles ont suscitées ont échoué. Une société détient le monopole de la distribution de nourriture à Moria et le gouvernement grec a toujours refusé de contester cet état de fait.
« Les gens font sans cesse la queue : quand ils arrivent au bout pour leur déjeuner, ils doivent commencer à faire la queue pour leur dîner. Ils dorment, et le lendemain lorsqu’ils se réveillent partent de nouveau faire la queue. »
« Si quelqu’un double dans la queue, qu’il vienne d’Afghanistan, de Syrie ou d’Afrique, ça rend la situation terrible pour tout le monde. Très souvent les tensions commencent dans la file d’attente et des bagarres éclatent le soir. »
« Tous les jours, mon mari fait la queue pour avoir à manger. D’abord, de 3 h à 8 h du matin. Cinq heures d’attente, rien que pour le petit déjeuner. Puis il retourne faire la queue de 11 h à 14 h. Trois heures pour le déjeuner. Et il y retourne à nouveau à 17 h et revient à 20 h, trois heures pour le dîner.
Il perd onze heures de sa journée, tous les jours, dans la file d’attente.
C’est horrible.
Je ne sais pas quel est l’avenir des réfugiés.
J’espère que quelqu’un nous aidera. »

Ces voix qui parlent de la file d’attente – et dont nous ne connaissons pas les noms – ont été enregistrées par Sahar Mousavi à l’intérieur du camp. La file d’attente, la « foodline », Sahar en a aussi enregistré le son. L’agitation, les bousculades, l’attente. Des voix d’hommes et de femmes qui crient. Ces cris qui résonnent. Beaucoup de monde.
De retour à l’atelier, Sahar a fait écouter à tous·tes les participant·es ses interviews.
La dernière voix était celle d’une de ses amies. La voix était lente, entrecoupée de sanglots. « J’espère que quelqu’un nous aidera », disait-elle, puis on entendait Sahar conclure précipitamment l’enregistrement, visiblement gênée d’avoir bouleversé son amie avec ses questions. « Je suis désolée de te voir si triste… J’espère aussi… Je suis désolée… », disait-elle, avant de couper brusquement l’enregistrement. Autour des micros, dans la cabane de l’atelier de radio, Sahar, écoutant de nouveau son amie au milieu des autres participant·es, s’était mise à pleurer doucement. Puis elle avait expliqué :
Sahar Mousavi : Le soir, après leur avoir parlé, j’étais très triste. Je ne pouvais pas m’arrêter de pleurer. J’ai pleuré en pensant à ma vie et à celle des autres réfugiés. C’était très dur.
Sahar cachait qu’elle pleurait, et comme elle se cachait, nous n’avons rien dit. Mais ce jour-là, nous avons compris que chaque jour, lorsque Sahar était avec nous à l’atelier, son mari resté à Moria faisait la queue, pour elle et pour sa fille. Il faisait la queue toute la journée. Ce que son amie disait en pleurant, Sahar aurait pu le dire, elle aussi. Et c’est en écoutant son amie le dire qu’elle pleurait.
Nous ne savions pas, comme les participant·es ne l’ont raconté que plus tard, à quel point ils et elles se mettaient en danger en emportant des enregistreurs.
Nous nous sommes demandé·es si nous n’avions pas fait une erreur en n’anticipant pas suffisamment comme il doit être douloureux d’entendre ses propres souffrances, que l’on essaie jour après jour d’affronter, racontées par quelqu’un d’autre. D’entendre tout à coup des mots décrivant ce que l’on est en train de vivre.
« J’ai pleuré en pensant à ma vie et à celle des autres réfugié·es », a dit Sahar. Un autre jour, Anoosh Ariamehr avait dit, en parlant d’une de ses premières interviews : « Chaque mot qu’il m’a dit, je le ressens. » Il l’avait dit en anglais : « Every word he said, I feel that. »
Sahar Mousavi : J’ai essayé d’interroger beaucoup de gens et la plupart refusaient de me parler devant un micro. Ils croient peut-être que ça va leur causer des problèmes. Sur toutes celles que j’ai interrogées, seules trois personnes ont bien voulu répondre.
Anoosh Ariamehr : Sahar, à Moria, il est interdit d’enregistrer ou de prendre des photos. C’est même écrit à l’entrée du camp. Et les journalistes ne peuvent pas entrer. Comment as-tu fait pour enregistrer ces interviews ? Tu les as enregistrées secrètement ?
Sahar Mousavi : Secrètement, oui. J’ai donné mon micro à mon mari, il l’a apporté en cachette dans la file d’attente et a enregistré. J’avais peur pour lui. Je me disais : « mon dieu, si quelqu’un l’agresse à cause du micro, qu’est-ce que je peux faire ? Qu’est-ce que je dois faire ? ». J’avais très peur pour lui. Je crois d’ailleurs que la dernière bagarre a éclaté à cause de quelqu’un qui voulait filmer la file d’attente, alors que d’autres ne voulaient pas être filmé·es.
Anoosh Ariamehr : Cet hiver, moi aussi j’ai voulu enregistrer la file d’attente, mais quelqu’un m’a suivi. Je me suis échappé et ai réussi à rentrer chez moi. Mais, après ça, je ne suis jamais retourné dans la foodline.
Alain Serge Soh : Moi aussi, vendredi, je suis tombé sur une bagarre dans le camp. J’ai essayé de prendre une vidéo mais tout le monde m’en a empêché. Tout le monde est inquiet dans Moria. Quand j’ai fait mes interviews, beaucoup étaient d’accord mais ne voulaient pas donner d’informations personnelles. Personne ne veut donner son nom. Ils veulent bien répondre aux questions mais ne veulent pas donner leur identité.
Anoosh Ariamehr : C’est parce que les gens ont peur du service d’asile et des grec·ques. Les gens pensent que si vous parlez du service d’asile ou de la gestion du camp, ils vous rendront la vie difficile, ils ralentiront le traitement de votre dossier. C’est pour cette raison que les gens ont peur de parler.

Parmi les quelques personnes qui ont accepté de répondre aux questions de Sahar, toutes ont refusé de révéler leur identité.
C’est également le cas des deux personnes qu’a enregistrées Alain Serge Soh, un soir, à l’intérieur du camp de Moria. Il fait nuit mais on entend, à l’arrière plan de ses enregistrements, que le camp est encore éveillé : des voix d’enfants, des téléphones qui sonnent, des gens qui discutent. Il doit être autour de 21 heures. Alain Serge Soh et l’un de ses amis sont assis dans l’un des containers transformés en dortoirs qui s’alignent et s’empilent à l’intérieur du camp.
Alain Serge Soh : Chers auditeurs, bonjour une fois de plus. Je suis ici au camp de Moria. J’ai un invité devant moi à qui je vais poser certaines questions. Il va essayer de nous apporter des éléments de réponse. Cher Monsieur, bonjour. Si je peux me permettre, vous estimez-vous en sécurité dans ce camp ?
L’ami d’Alain : (Silence.) Dans un… (Il soupire.) Pratiquement pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au début quand on arrive, on se dit qu’on sera sécurité, mais malheureusement à peine arrivé, j’ai fait trois mois de détention, et jusqu’à aujourd’hui on ne m’a jamais expliqué pourquoi… Je suis un peu, toujours… J’ai toujours cette question-là qui me taraude l’esprit : pourquoi ai-je fait de la prison ? Jusqu’à présent, je n’ai pas de réponse. Et le fait que dans le camp, il y a tellement de bagarres, pendant certaines nuits, des gens de différents pays qui se battent, qui cassent tout, qui essayent d’agresser n’importe qui, je trouve ça un peu difficile. C’est ce qui fait que je ne me sens vraiment pas en sécurité jusqu’à présent.
Alain Serge Soh : Pouvez-vous nous dire quel est votre avis par rapport au service d’asile ? Est-ce qu’on vous reçoit assez rapidement, ou estimez-vous que le temps d’attente est vraiment trop long ?
L’ami d’Alain : Ça, c’est une autre chose importante. Le temps d’attente est énorme. Le service d’asile ici, je me permets de dire que c’est vraiment lent. Pour obtenir un rendez-vous, rien que pour voir un docteur, c’est toute une longue histoire. Pour ton interview, tu peux passer deux, trois, quatre, peut-être même six mois sans avoir de date. Ceux qui ont de la chance parviennent en deux ou trois mois à savoir quelle sera leur date d’interrogatoire d’admission. Et par exemple, actuellement, les nouvelles personnes que je côtoie ont leurs dates qui sont prévues pour l’année prochaine. Pour dans un an. Et puis c’est compliqué avec les conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons. Les délais sont énormes.
Alain Serge Soh : Merci Monsieur. J’ai une autre question pour vous : par combien de pays êtes-vous passé pour arriver ici ?
L’ami d’Alain : Par un pays. Après mon pays je suis allé en Turquie, puis directement ici.
Alain Serge Soh : Et si je peux me permettre, pourquoi est-ce que vous n’êtes pas resté en Turquie ?
L’ami d’Alain : Ce qui m’a poussé à fuir mon pays ne me permettait pas de rester en Turquie. Ce pourquoi j’ai quitté mon pays, la loi turque non plus ne l’accepte pas. Je suis homosexuel. Dans mon pays, c’est fermement condamnable. Terrorisable, même. Une fois qu’on te soupçonne d’être homosexuel·le, tu commences à vivre le martyre. Et en Turquie aussi, c’est pareil. Donc je me suis dit qu’en venant en Grèce, je pourrais au moins trouver un peu de sécurité, parce que ici au moins on fait l’effort d’appliquer les droits de l’homme.

Alain Serge Soh salue ses auditeurs, puis remercie son invité en lui disant au revoir. L’enregistrement grésille et s’éteint.
Chaque soir ils sont huit à s’endormir dans le même container.
Dès le premier jour des ateliers, Alain Serge Soh a évoqué son incarcération. À son arrivée sur l’île, quelques mois auparavant, le matin de sa traversée, il avait été envoyé en prison pour trois mois. Trois mois, c’est la durée légale maximale pour ce type d’incarcération.
Ce n’est pas le cas de tous les demandeur·ses d’asile qui arrivent sur l’île après avoir été « lancé·es à la mer » par les passeurs, comme le dit Alain Serge Soh. Pourquoi cet homme a-t-il été jugé plus dangereux qu’un autre ? Pourquoi Frontex (l’Office de police européen) a-t-il estimé nécessaire d’incarcérer des hommes qui se trouvaient déjà bloqués sur un territoire entouré par la mer (le ferry pour Athènes, sur le port, est étroitement surveillé par la police et les membres d’équipage) ? Comment les autorités tracent-elles le partage entre les vies qui méritent d’être libres et celles qui ne le méritent pas ? Nous avons cru comprendre que la sélection était faite, la plupart du temps, de manière aléatoire, en fonction des pays ou des zones géographiques dont sont originaires les populations incarcérées, en fonction des capacités d’enfermement de la prison surtout. Nous savons seulement qu’il s’agit toujours d’hommes seuls, jamais de couples ou de familles. Et qu’ils sont toujours originaires de pays africains : le Congo, la Côte d’Ivoire ou le Cameroun. C’est ce qui est arrivé à Alain Serge Soh et à plusieurs de ses amis. À la fin des trois mois, tous sont sortis de la prison pour aller vivre dans les tentes ou les containers du camp, et ont repris comme les autres leur procédure administrative.
Un soir, avec son téléphone, à l’intérieur du camp, Alain a enregistré l’un des autres hommes avec qui il partage son container. Lui non plus ne souhaite pas donner son nom : il se fait appeler Monsieur L’Empereur.
Alain Serge Soh : Bonjour, bonjour une fois de plus chers auditeurs de Focus radio. Nous sommes ici en présence de Monsieur L’Empereur.
Une question audacieuse me vient à l’esprit, celle de savoir si vous êtes heureux ici ?
Monsieur L’Empereur : Ici, je peux dire que je suis heureux parce qu’ici, au moins, j’ai la vie saine et sauve. Au moins, je sais que je peux avoir un espoir pour le lendemain. Mais… les conditions de vie nous rendent vraiment malheureux. Ce que nous espérions n’est pas ce que nous vivons ici. Par exemple, quand tu es malade et que tu dois aller à l’hôpital : on n’arrive pas à te recevoir… Pendant une, deux semaines… Ça fait un peu mal, ça fait que souvent tu te dis… mais où est la vie ? Mais où est l’espoir dont on nous parle ? Voilà. On a un espoir pour demain mais, pour le moment, les conditions ne sont pas réunies ici. C’est pas facile d’avoir de la nourriture. Ce n’est pas non plus facile d’avoir des soins. Je m’estime heureux parce que j’ai la vie saine et sauve, mais de façon générale je ne suis pas heureux parce que je ne vis pas dans les conditions qu’il faut. Voilà.
Une des préoccupations des émissions de radio enregistrées durant les ateliers a été la question de la langue, la difficulté de communiquer au sein d’un camp où les femmes et les hommes qui vivent ont parfois parlé des dizaines de langues différentes.
Et il faut aussi dire un mot, à cet égard, des témoignages que nous retranscrivons ici. La plupart d’entre eux sont traduits depuis l’anglais. L’anglais est devenu, par défaut, la langue des échanges au sein des ateliers. Mais pas toujours. Parfois, une étrange chaîne se mettait ainsi en place. On entendait un afghan interroger un camerounais sur sa vie à Moria grâce à la traduction du farsi à l’anglais d’un iranien puis de l’anglais au français d’un congolais. À la fin de sa réponse, adressée droit dans les yeux à son intervieweur qui ne le comprenait pas encore, la chaîne repartait dans l’autre sens.
Dans le camp, il arrive que les langues, anglais, grec, farsi, arabe et français, se mélangent, créolisation nécessaire à la situation de Moria. Certains appellent cette langue le moriantais.
Anoosh Ariamerh (riant) : Il y a cette « langue spéciale de Moria ». Les Arabes ne parlent pas les langues africaines, les Africains ne parlent pas l’arabe ou le farsi mais quand ils se rencontrent, ils peuvent se comprendre, grâce à la langue spéciale de Moria.
Quelques mots et quelques signes seulement permettent de résoudre beaucoup de problèmes, cela m’a beaucoup frappé.
Alain Serge Soh : Oui, Moria est le seul endroit où l’on peut voir quelqu’un utiliser quatre langues différentes en une seule phrase… J’aime beaucoup mélanger les langues… (riant) Et puis (le ton change brutalement) si tu ne le fais pas, tu restes triste avec trop de problèmes en tête. Moria est un endroit très difficile, et si tu n’as pas une direction, si tu ne te préoccupes pas de ton futur, si tu ne penses pas à tes rêves et à toutes ces choses, tu peux t’effondrer…

Anoosh Ariamerh, avec l’enregistreur que nous lui avions prêté, a enregistré la mer. C’était pour l’une des dernières émissions. Tous·tes avaient choisi de parler des raisons pour lesquelles les gens quittent leurs pays. Ils et elles cherchaient quel son faire entendre. Et Anoosh avait proposé d’enregistrer la mer, car, avait-il dit, toutes les personnes qui ici ont fui la misère ou leur pays en guerre sont allées jusqu’à la mer, puis l’ont traversée. Un soir, il est allé seul avec son enregistreur sur une plage de l’île. Il y avait beaucoup de vent et de fortes vagues. Depuis la rive, le son n’était pas encore celui de la mer. Anoosh a retiré ses vêtements, puis, avec l’enregistreur à la main, il est entré dans l’eau jusqu’à la taille. Il a mis l’enregistreur près de l’eau, et a enregistré le son puissant de la houle, le vent qui tourne, l’eau qui se soulève.
Zahra : Bonjour, vous entendez ma voix sur Radio Azaadi, Radio liberté. Je suis avec mon ami Ali, qui a enregistré le son de la mer, pour ouvrir cette émission. Je trouve ce son doux, il est très calme. Mais je voudrais lui demander pourquoi il l’a enregistré ?
Ali Mousavi : Bonjour Zahra, et bonjour à vous tous qui entendez nos voix. J’ai enregistré le son de la mer en allant pêcher avec mon fils. On est allés sur la côte pour essayer d’attraper du poisson. J’avais prévu d’interviewer un de mes amis mais il était occupé. Alors j’ai enregistré la mer. Et finalement, j’aime ce son moi aussi, il me calme. Je n’avais jamais vu la mer avant d’arriver en Turquie.
Quelques mois plus tard, quand nous sommes retourné·es à Lesbos pour de nouveaux ateliers de radio, Ali Mousavi a lui aussi enregistré la mer. Mais ce n’était pas, comme Anoosh, pour faire entendre la violence du départ. Pour lui c’était au contraire quelque chose qu’il n’avait jamais vu ni en Afghanistan, où il est né, ni en Iran, où il a été réfugié presque toute sa vie. Alors le son de la mer avait la douceur de l’espoir d’une vie différente.
Il était calme, bien plus paisible que le son enregistré par Anoosh.
Zahra, jeune fille née en Iran, présentait cette émission. Mehdad, iranien lui aussi, participait à la conversation et traduisait certains propos en anglais. Ali Mousavi était assis à côté de sa femme et de son fils de cinq ans, installé près de lui pendant toute la durée de l’enregistrement.
Zahra : Nous sommes Radio Azaadi, Radio liberté, et nous émettons depuis l’île de Lesbos. Aujourd’hui nous allons parler de ce que ressentent les réfugiés sur l’île. Je m’appelle Zahra. Je suis avec Mehdad, Ali et sa famille, sa femme et son fils Amir. Que pouvez-vous nous dire de vos sentiments en tant que réfugiés ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Mehdad : Le fait d’émigrer est quelque chose qui fait peur. Il faut quitter ses traditions, sa famille, quitter toute sa vie pour aller dans un pays dont vous n’aimerez pas nécessairement la façon de vivre, la nourriture, les traditions. Je pense que les réfugiés sont des gens courageux. Oui… Ils surmontent des choses et des problèmes très durs.
Zahra : C’est vrai, je suis profondément d’accord avec vous. Seulement les réfugiés ne sont pas voulus, ils sont considérés comme des gens en trop.
Ali Mousavi : Je veux insister aussi sur le fait que les gens sont forcés de devenir réfugiés. Si j’avais pu être en sécurité dans mon pays, je ne l’aurais pas quitté.
Zahra : Je suis d’accord. Les gens qui endurent de telles difficultés le font parce qu’ils ont des raisons de le faire, parce qu’il y a dans leur pays une guerre qu’ils n’ont pas choisie, parce qu’on les a poussés dedans… Ces gens-là n’ont pas le choix. Ils doivent quitter leur pays avec leur famille, leurs enfants pour les emmener dans un endroit plus sûr. C’est le droit de n’importe quel être humain. Un droit à la vie, je veux dire. Et puis, la guerre mise à part, il y a les atrocités endurées par les gens pour arriver jusqu’ici. Les espoirs qu’ils avaient en venant se heurtent aux problèmes qu’ils rencontrent en arrivant.
Ali Mousavi : Cela fait vingt, trente, quarante ans que notre pays, l’Afghanistan, est en guerre et que nous vivons dans l’insécurité. J’ai un peu plus de trente ans et cela fait trente ans que je suis un réfugié, que je suis un migrant. Je suis en Iran depuis trente ans. La vie est déjà difficile pour les Iraniens, elle l’est encore plus pour les personnes réfugiées en Iran.
Je n’ai pas pu aller à l’école, pas un seul jour, pendant ces trente ans.
Nous avons plusieurs fois essayé de rentrer en Afghanistan. La province où je suis né est très dangereuse. La guerre ne s’arrête jamais. Les seuls souvenirs que j’ai de ce lieu, ce sont des souvenirs de gens tués, de la violence et de la guerre. J’avais 5 ou 6 ans et, de mes propres yeux, je voyais les gens se faire tuer. Vraiment, j’ai peur d’y retourner.
Zahra : Et si votre pays redevenait un pays sûr, est-ce que vous y retourneriez ?
Ali Mousavi : Je ne sais pas quoi penser d’un pays qui ne vous aime pas, qui ne vous connaît pas, qui ne se soucie pas de vous. On ne peut pas appeler cela un pays. Un pays est un endroit où l’on peut avoir de l’espoir dans l’avenir, un lieu où vos enfants peuvent étudier, recevoir une éducation, suivre leurs rêves. Nous avons tenté à plusieurs reprises de rentrer. Sans succès. L’un de mes oncles a essayé, et son fils, mon cousin, est mort.
Zahra : Je suis née en Iran. En tant que réfugiée, j’aimerais pouvoir retourner dans mon pays et ne plus jamais être en guerre.
Mais aujourd’hui, l’un des problèmes pour moi, c’est le document de la vulnérabilité. L’une des façons d’accélérer les procédures. Si les gens n’ont pas un problème de santé, il faut être une femme célibataire, ou enceinte. Moi, toute ma famille a été reconnue comme vulnérable, mais pas moi, parce que j’ai plus de 18 ans. Alors j’ai voulu contester cette décision. Avec mes parents et mes frères et sœurs, je suis la seule à ne pas pouvoir quitter l’île. Pour l’instant ils m’attendent… Mais l’employé m’a dit « va-t-en, et sois heureuse parce que tu es en bonne santé et tu n’es pas vulnérable ». Et maintenant, je ne sais pas ce que je devrais faire.

Il ne faut pas confondre le statut de « personne vulnérable » et ce que les participant·es des ateliers appellent la « vulnérabilité ». Les demandes d’asile formulées par les réfugié·es arrivés sur l’île de Lesbos sont examinées au regard des critères de la loi grecque. Celle-ci reconnaît dans ses textes la notion de « personne vulnérable », applicable à l’une des catégories suivantes : les enfants réfugiés non accompagnés, les personnes pouvant prouver qu’elles ont été torturées dans leur pays d’origine ou durant leur fuite, les femmes enceintes, les victimes de maladies graves, les victimes de violences dans leur pays d’origine ou au cours de la fuite, les survivantes et survivants de naufrages. À Lesbos, les camps de Pikpa et de Kara Tepe, de plus petite taille, sont destinés aux réfugié·es les plus vulnérables. Pour être reconnu·es comme vulnérables, certain·es tentent de se faire passer pour « fous·lles » ou dépressif·ves, et parfois le deviennent vraiment. Un jour, Nicolas, jeune camerounais, nous a raconté qu’un de ses amis était allé voir un psychiatre pour se faire passer pour fou et essayer d’être reconnu comme « vulnérable », afin d’accélérer les procédures. Il s’est fait prescrire des médicaments. « Aujourd’hui, il ne sait plus dire comment il s’appelle », nous a dit Nicolas.
L’île de Lesbos est à huit kilomètres des côtes Turques. L’île sèche est bordée d’oliviers et les routes étroites serpentent lentement, en lacets, dans la montagne. En montant dans ces montagnes, on traverse des villages qui peuvent sembler lourdement endormis depuis des décennies. Ils sont chargés de pauvreté et de ce qu’on appelle histoire, de toutes ces choses qui leur appartiennent et qu’il est difficile de comprendre. Ballotté par le langage, on écrirait volontiers sur la beauté pittoresque de ces lieux en oubliant de rappeler la misère et les difficultés des femmes et hommes qui y vivent.
Un photographe nommé Ahmad Ebrahimi, réfugié lui aussi et qui travaillait bénévolement dans le centre où avaient lieu, avant le feu, les ateliers de radio, a pris des centaines de photos de Moria : le camp, les arbres brûlés, les tentes, les filets tendus pour retenir la terre, les trous sous la terre pour cuire le pain, et surtout les habitant·es provisoires de ces espaces infirmes, beaucoup d’adultes et encore plus d’enfants. Plusieurs de ces photographies ont en commun la place que le ciel creuse sur la page de l’image : par-dessus les scènes ordinaires de la misère du camp, le ciel du jour, ces ciels immenses qu’il y a au-dessus de l’île. Dans un camp à ciel ouvert, immense, des bâches au sol, l’odeur des excréments, les douches qu’on ne nettoie pas, la nourriture crue qui rend malade parce que, doit-on penser presque professionnellement, ceux et celles à qui on la sert peuvent bien tomber malades.

Pour aller plus loin
- Le site de radio monobloc, avec d’autres émissions enregistrées à Lesbos par la même équipe ;
- Une série d’émissions diffusées sur France Culture ;
- Les analyses de Migreurop sur « l’approche hotspot » et les nouvelles formes de confinement aux frontières de l’Europe, ici et là.