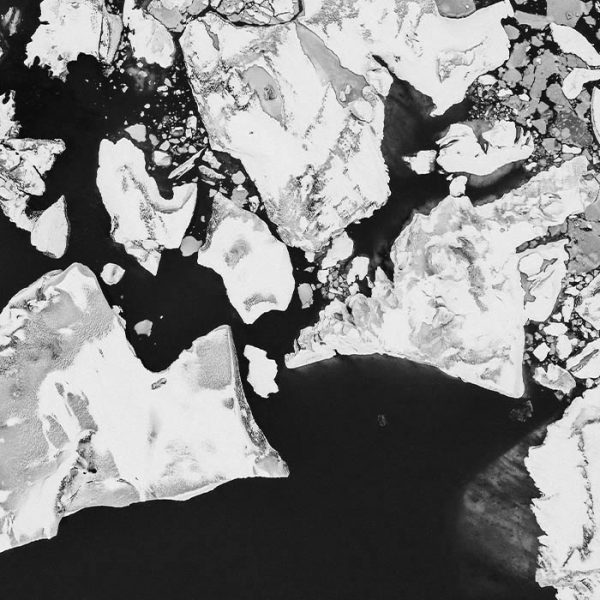Livre d’histoires et d’analyses politique, boîte à outils, auto-enquête, recueil de chansons, collection de tracts, livre partisan qui ne dit jamais « je » mais donne à entendre des centaines de voix, L’Orda d’oro est à ce jour le seul livre qui évoque aussi complètement la foisonnante inventivité sociale, théorique, culturelle et langagière de l’Italie des années 1960-1970. Et il aura fallu attendre le printemps 2017 pour retrouver cette histoire en hexagone, grâce à la traduction aux éditions de l’Éclat, enrichie par le collectif de traduction d’un appareil de notes indispensable au lecteur français 1.
En ces temps de crise « créative, politique, et existentielle », Jef Klak a décidé de mener trois entretiens avec les traducteurs et traductrices afin de parcourir avec eux cette période fondatrice de notre présent, inspirante pour nos luttes.
Pouvez-vous commencer par nous raconter la genèse de ce livre ?
En 1987, la maison d’édition Sugarco propose à Nanni Balestrini 2, poète des avant-gardes italiennes du milieu du siècle, de publier un livre pour commémorer les 20 ans de 1968. Ce dernier détourne la commande pour en faire un livre collectif sur le « Mai rampant » italien (1968-1977), cette période qui est encore à l’époque largement diabolisée, comme en témoigne l’expression « années de plomb » employée par médias et gouvernements. La Horde d’or propose une contre-histoire de cette décennie de luttes, en l’inscrivant dans une temporalité plus large, qui commence dans l’immédiat après-guerre et se termine en 1980 avec la « Marche des quarante-milles » à Turin 3.
Aux côtés de Balestrini, on trouve Primo Moroni 4, le libraire de La Calusca-City lights à Milan. Montage hétéroclite, le livre s’est constitué à partir d’une multitude de matériaux que Moroni, archiviste obsessionnel, avait conservés : des livres évidemment, mais aussi des tracts, des bulletins ronéotés, des affiches, des fanzines, etc. La librairie Calusca n’était pas le centre d’archives qu’elle est devenue aujourd’hui, mais elle se voulait une caisse de résonance du mouvement, un espace de diffusion, mais aussi de production et de publication. Elle a ainsi accueilli et édité des revues importantes comme Primo Maggio ou Controinformazione, et mis en place une structure de diffusion à l’échelle nationale, la coopérative Punti rossi. Elle a aussi coordonné l’une des premières productions alternatives dans le domaine pédagogique, l’encyclopédie Io e gli altri (Moi et les autres), manuel pluridisciplinaire à l’adresse des collégiens. La musique et les productions contre-culturelles, y compris orales, y avaient aussi leur place. Elles étaient reconnues comme faisant partie intégrante du mouvement, ce dont le livre se fait l’écho.
Une troisième personne participe à l’élaboration de La Horde d’or : Sergio Bianchi, un militant de l’autonomie des années 1970 – Balestrini était, lui, plutôt identifié à la génération des années 1950, tandis que Moroni l’était à celle des années 1960. Bianchi sera surtout à l’origine de la deuxième édition du livre, en 1997, avec de nombreux ajouts de textes (et quelques disparitions aussi).
Le livre se veut avant tout interne au mouvement. Il adopte d’emblée le point de vue « partial » des luttes, tout en s’efforçant de donner voix aux différentes sensibilités, tendances, fractions, et histoires. Si bien qu’il est généralement considéré par les protagonistes de l’époque comme l’ouvrage à la fois le plus juste et le plus honnête sur cette période.
Pouvez-vous revenir sur le contexte italien des années 1980 ?
Le livre est mis en chantier en 1987, dans un paysage politique totalement dévasté. Suite à la répression de masse qui a eu lieu après 1979, des milliers de personnes sont encore emprisonnées ou en exil. Les années 1980 ont totalement refoulé les décennies précédentes. C’est une grande période de vide, où le passé n’est plus tant attaqué qu’occulté.
Pour ne parler que des livres, l’intense activité éditoriale des années 1960 et 1970 a été suivie d’un net reflux à partir de la fin des années 1970. Beaucoup de gens se sont débarrassés des documents ou des matériaux incriminants qu’ils possédaient. Les maisons d’édition ont mis au pilon des collections entières : analyses des mouvements de classe, discussions internationales, livres révolutionnaires, théoriques, d’intervention, etc. D’où l’importance des archives Moroni, un des rares endroits d’Italie qui ait conservé ces traces de la contre-histoire ouvrière et sociale de l’Italie d’après-guerre.
La Horde d’or a été conçu sous le poids d’une double contrainte : d’une part la répression toujours en cours, avec des milliers de détenus et de procédures judiciaires, de l’autre des dissensions politiques intenses entre les différentes fractions du mouvement. Le livre est très marqué par cette volonté de ne pas s’embarquer dans l’exposition des désaccords, pour ne pas prêter le flanc à l’appareil judiciaire et policier, mais dans le même temps, il prend un soin scrupuleux à faire apparaître le plus fidèlement possible les différentes positions qui coexistaient au sein du mouvement.
Les journées de juin et juillet [1960] ont eu une résonance profonde au sein du prolétariat italien. Tandis qu’à Gênes l’expression « faire comme Tokyo » courait de bouche en bouche, devenant une sorte de mot d’ordre, à Turin et dans les autres villes italiennes, les travailleurs disaient : « Il faut faire comme à Gênes », et les ouvriers ajoutaient : « Notre patron, c’est le fascisme ». Et pourtant, à Gênes comme ailleurs, les travailleurs et les jeunes ne se sont pas heurtés seulement aux forces de répression : ils ont également dû affronter les dirigeants de gauche qui tentaient de freiner leur action, de la confiner dans une dimension strictement légale et inoffensive. […] Il faut souligner ceci : en juillet, les ouvriers et les jeunes revendiquent des formes de lutte que les organisations traditionnelles n’étaient pas en mesure de proposer. (La Horde d’or, p. 34)
Comment expliquez-vous le choix inaugural de faire déborder cette « contre-histoire du Mai rampant » très en amont de la période 1968-1977 annoncée en couverture ?
L’insurrection de Gênes est considérée comme le point de départ de la reprise des luttes dans les années 1960. C’est la première rupture manifeste avec le consensus d’après-guerre fondé sur l’idéologie de la Reconstruction 5.
Pour le raconter rapidement, le 2 juillet 1960, le MSI 6, parti néo-fasciste, prévoit de tenir congrès à Gênes, ville ouvrière et partisane 7, foyer de la résistance pendant la guerre. Une mobilisation contre la tenue de ce congrès fasciste s’organise, alliant syndicats, partis, organisations historiques de la gauche, et d’innombrables acteurs moins identifiables : jeunes et vieux, anciens résistants, ouvriers, etc. Et alors qu’il ne s’est à peu près rien passé en termes de conflictualité politique depuis la fin de la guerre, ces manifs, conçues par leurs organisateurs comme des protestations pacifiques, tournent rapidement à l’émeute. Tout le monde tombe des nues, à commencer par la gauche et les intellectuels. Tous se demandent qui sont ces gens qui s’opposent aussi frontalement au retour du fascisme et au gouvernement qui a autorisé ce congrès.
On ne peut pas comprendre les journées de Gênes si on ne tient pas compte du fait que la résistance partisane, en Italie, n’a pas consisté à chasser un occupant extérieur, mais à combattre l’État italien. Une fois l’État fasciste vaincu, beaucoup de partisans, dans leur grande majorité communistes, voulaient prendre le pouvoir par les armes. Togliatti, secrétaire général du Parti communiste italien (PCI), a coupé court à ces élans révolutionnaires, en imposant un discours du type : « Déposons les armes, retroussons-nous les manches pour reconstruire le pays et prenons le pouvoir par la voie démocratique. » C’est ce qu’on a appelé la « Longue marche à travers les institutions », une orientation que l’on retrouvera au PCI jusqu’au « Compromis historique 8 ».
Une partie importante des émeutiers de Gênes était vraisemblablement constituée de cette composante dite de la « résistance trahie » : ces partisans qui auraient voulu ne pas rendre les armes – et qui bien souvent ne les ont pas rendues ! Ils les ont planquées dans les montagnes, où elles ont soit rouillé soit, selon la légende, contribué à des actions plus tard. On retrouve en effet deux décennies après quelques anciens partisans dans des groupes armés, où ils rejoignent de jeunes militants à qui ils apportent, dit-on, leurs armes, mais aussi leur expérience, leurs conseils, et surtout leur légitimité. Le livre montre bien comment la lutte armée des années 1970 s’enracine dans l’histoire ouvrière et s’ancre dans un imaginaire de la Résistance, en opposition à la ligne du PCI.
Une autre composante de ces journées d’émeutes est la jeunesse, qui ne peut pas se comprendre selon les catégories du mouvement ouvrier traditionnel. Pour analyser cette révolte, son caractère offensif, il faut saisir des cheminements subjectifs, qui puisent dans un répertoire imaginaire bien plus vaste, où la géopolitique mondiale côtoie le rock’n roll et le cinéma. Le sous-titre du livre, La grande vague révolutionnaire et créative, politique et existentielle, montre qu’on n’y parle pas seulement de politique au sens classique du terme. La dimension existentielle est une ligne de fond, transversale au sommaire. Elle recoupe en partie la notion de « pré-politique », également présente dans l’ouvrage pour dire l’importance d’éléments sensibles, subjectifs, imaginaires dans la constitution des comportements de révolte politique proprement dits. C’est là quasiment une autre « thèse » du livre, ou tout du moins un de ses schémas récurrents pour interpréter le cycle de lutte des années 1960-70. La grande « vague » de révolte et de dissensus va d’abord s’implanter dans les corps, les sensibilités, les comportements, avant de se massifier et se généraliser à l’ensemble de la société : au travail, à l’université, dans la famille, dans les quartiers… Dans la genèse de l’autonomie italienne, l’affirmation de comportements et de subjectivités antagonistes, ne relevant pas immédiatement d’une logique « politique » ou « idéologique », est essentielle. C’est aussi ce qui ouvre la lecture à ce que les intellectuels d’alors appellent « culture de base ».
Comment vous définiriez cette « culture de base » ?
La « culture de base », c’est à la fois le chant populaire, le rock’n roll, l’histoire du mouvement ouvrier, l’analyse des transformations du capitalisme. C’est autant lire la presse que discuter du capital ou du bilan politique d’une grève… Ce n’est donc pas seulement une contre-culture esthétique, sensible, ou quotidienne. Il y a aussi une dimension théorique – mais pas de la théorie pour les théoriciens. On peut ainsi considérer d’une certaine façon les opéraïstes 9. comme un des versants de la contre-culture dont il est question dans le livre.
La culture de base, c’est toutes les formes de subjectivité, d’inventivité populaires qui sont de l’ordre de la mémoire de classe. Une mémoire de fond, qu’ont cherché à restituer des expériences comme le Nuovo canzoniere italiano (NCI) relatée dans le livre. Fondé par Gianni Bosio 10 le NCI a été à l’origine d’un énorme chantier sur la chanson populaire, qui a servi à recueillir et archiver les folk songs de l’Italie lointaine, rurale ou ouvrière, puis à en faire des outils d’intervention. Gianni Bosio était à l’origine salarié dans un des instituts Feltrinelli 11 pour la culture populaire, financés par le PCI. Son idée était de promouvoir la culture ouvrière comme une culture en soi, méritant étude à part entière. Et puis à un moment, le PCI considère que ça va un peu trop loin, et demande à Feltrinelli de virer Bosio, qui fonde avec ses indemnités de licenciement sa propre maison d’édition, Avanti !
L’idée selon laquelle le mouvement ouvrier a une histoire propre – pas une sous-histoire, une sous-catégorie de l’histoire bourgeoise –, ne relève pas uniquement de l’existentiel, du pré-politique pas plus qu’elle n’appartient aux opéraïstes. C’est une idée qui a traversé le PCI, puis qui en a été expulsée pour des raisons politiques, mais qui est très ancrée en Italie.
Affirmer, comme le fait ce livre, que le mouvement, c’est aussi la chanson sociale, les dissidences intellectuelles, les expériences contre-culturelles, les manières de vivre, etc., c’est rappeler que l’organisation politique échappe à la mainmise du Parti et passe par tous les domaines de la société : école, église catholique, musique, magistrature, médecine, psychiatrie, production éditoriale, etc. Cela permet de retracer une contre-histoire de l’organisation politique au sens large.
On découvrait que la violence, c’était la violence du rapport de production capitaliste ; que la résistance se jouait sur la chaîne de production, là où chaque acte de production était dicté par la machine et par l’ensemble des éléments de commandement qui déterminaient la position de l’ouvrier à l’intérieur de l’usine. La méthode était donc la suivante : il fallait découvrir la vérité de la synthèse capitaliste à travers l’émergence de la résistance ouvrière. C’était la lutte qui, à chaque instant, expliquait la structure objective du capital en tant qu’il était lutte, c’étaient tous les moments de refus, de rébellion, de sabotage qui révélaient jour après jour comment était organisé le pouvoir du capital dans l’usine. Lire en ces termes Le Capital – et l’œuvre de Marx en général – devenait une arme puissante pour l’interprétation des faits. (La Horde d’or, p. 48)
Pouvez-vous revenir un peu plus précisément sur ce courant marxiste italien appelé « opéraïsme » et son influence sur La Horde d’or?
De nombreux chapitres reprennent ou citent un discours marxiste ou paramarxiste – de Mao Tsé Toung à Che Guevara en passant par les situationnistes… Mais ce qui prédomine en matière de marxisme tout au long de ce livre, c’est un marxisme singulier, étrange, spécifique à la configuration politique, intellectuelle, de l’Italie. Ce marxisme hétérodoxe met au cœur de l’analyse l’activité ouvrière et la lutte, ce qu’ils appellent le point de vue ouvrier. Cela se traduit par l’emploi d’un vocabulaire spécifique. Ainsi, le terme « antagonisme » est-il par exemple beaucoup plus présent dans le livre que celui de « dialectique ».
Le courant opéraïste naît à la fin des années 1950. Malgré une grande sophistication intellectuelle et théorique – Gramsci, Bordiga 12, etc. –, malgré les roueries rhétoriques permises par la dialectique marxiste (qui permettent au PCI de dire que produire, c’est préparer le socialisme), il se passe des choses inexplicables d’un point de vue marxiste orthodoxe – comme la répression des conseils ouvriers par l’Armée Rouge à Budapest en 1956 –, ou totalement imprévues – comme l’insurrection de Gênes en 1960. La gauche institutionnelle, que ce soit sur le plan des discours ou celui des organisations, est ébranlée par la réalité. Aux marges du parti socialiste – ou plus rarement du PCI –, les futurs opéraïstes ont pris leurs distances avec cette gauche très intégrée, qui se définit par ses alliances et ses velléités gouvernementales, et qui, loin de mettre en cause le développement capitaliste, cherche à y contribuer activement. Cette nouvelle génération d’intellectuels préfère aller voir ce qui se passe réellement dans la société. Rester marxiste au sens basique du terme – comprendre pour transformer et donc s’essayer à une analyse concrète des phénomènes concrets –, plutôt que de suivre le marxisme institué.
Après-guerre, l’Italie connait une profonde restructuration productive. L’introduction de la chaîne de montage va faire apparaître une figure nouvelle, celle de l’« ouvrier masse », l’ouvrier à la chaine, qui sera l’acteur principal du « boom économique » et des luttes des années 1960. Cela se passe à un moment où le PCI tourne le dos à la lutte et lance son appel interclassiste à la reconstruction du pays : c’est la grande nation en marche, tout le monde doit retourner au travail. Pour justifier son existence en tant que Parti « communiste », il continue à s’intéresser aux luttes socialistes internationales, mais se détourne des usines italiennes, qu’il laisse sans aucun contre-pouvoir. C’est vers ces usines, abandonnées par le PCI, que les intellectuels opéraïstes se tournent. Il s’agit de relire Le Capital de Marx à la lumière de la restructuration productive, et donc d’aller enquêter dans les usines pour comprendre comment le capital fonctionne.
Les opéraïstes retournent dans l’usine pour lire Marx au présent et retournent à Marx pour comprendre quelque chose de l’usine. Ils analysent le fonctionnement de l’usine pour comprendre la lutte, et ils regardent les luttes – qui n’ont pas disparu malgré la désertion du PCI – pour comprendre la dynamique du capital ; un terrain que plus personne n’essaie de comprendre depuis longtemps.
C’est à l’intérieur de ce programme de recherche et d’intervention qu’émerge la notion de refus du travail comme concept clé de l’opéraïsme : ne pas considérer le travail seulement comme un mécanisme économique, avec l’extraction de la plus-value dans ses divers stades, mais étudier l’existence politique du travail vivant. Cela implique de regarder ce qui se passe dans l’usine, ce qu’est réellement l’extraction de la survaleur, et surtout ce qui y résiste. Du coup, des comportements comme le sabotage ou l’absentéisme, impensables pour un PCI qui veut reconstruire le pays, redeviennent en revanche centraux dans la pensée opéraïste.
Comment se fait-il que ces salauds d’ouvriers ne font pas ce que dit le PCI ? Le message est pourtant clair : on doit produire, ne pas faire grève, veiller sur l’outil de travail qui sera bientôt le nôtre puisqu’on va collectiviser la production, socialiser l’outil de production… ! Comment peuvent-ils se détourner de cette ligne, pourquoi, et avec quel niveau d’organisation ?
Pour répondre à ces questions, les opéraïstes vont mettre en rapport un certain nombre de sphères habituellement séparées. La politique est aussi dans la culture de masse ou dans la culture de base. Lire l’exploitation, ce n’est pas seulement lire un rapport économique dont on ferait la critique, c’est lire un rapport politique, un rapport de pouvoir. C’est ça, l’apport le plus évident de l’opéraïsme, qui va bien au-delà de l’analyse du travail et des luttes ouvrières : il est possible de lire politiquement les comportements, les situations conflictuelles, ou les écarts par rapport aux rôles sociaux.
Si, à Gênes, la police est mise en difficulté pendant quatre jours, si la gauche est si souvent obligée de suivre un mouvement qui lui échappe, qu’elle n’arrive pas à empêcher, c’est qu’il y a des formes d’organisation sous-jacentes et des subjectivités nouvelles. Il faut enquêter sur ces réalités, car c’est là que se lit la politique : du côté du conflit, loin d’on ne sait quelle prévision théorique. La prévision théorique du Parti, jusqu’ici, c’était qu’une classe ouvrière organisée allait relancer la production et prendrait le pouvoir dans le cadre des institutions. Mais tout d’un coup, on voit apparaître un prolétariat qui n’a rien à voir avec ça.
Ces analyses trouvent une réponse inespérée dans le renouveau des luttes ouvrières du début des années 1960, et notamment en 1962, avec une grève énorme à Turin, la « ville-Fiat », qui voit les ouvriers sortir des usines et converger vers la piazza Statuto pour en découdre. C’est une sorte de première émergence de la figure de l’ouvrier masse, qui va être une des théorisations fortes du courant opéraïste.
La composition de classe avait changé et de ce fait les comportements, les pratiques et les rythmes de conflit de classe commençaient à changer, tout comme avaient changé les modalités de l’accumulation capitaliste et de l’extraction de la plus-value pendant la Reconstruction. Mais il était plus aisé de reconnaître les transformations du capital que celles de la classe ouvrière. Il était plus facile d’analyser les bouleversements dans la composition du capital fixe et les formes de son despotisme que d’accepter les formes de subjectivation et de révolte ouvrières face à des conditions de vie et travail intolérables – a fortiori quand elles s’exprimaient par des comportements anomaux, imprévus, inconnus, ingouvernables et complètements étrangers à la discipline et aux règles politiques et syndicales qui avaient prévalu dans les années 1950, tout au long de l’interminable Reconstruction. Piazza Statuto est l’indice que les sujets et les formes de la conflictualité sont en train de changer, qu’ils ne sont plus régis par une périodicité mécanique mais qu’ils sont entrés dans une conflictualité permanente. […] C’est piazza Statuto que commence l’histoire du mouvement de l’autonomie ouvrière en Italie. (La Horde d’or, p. 140-141)
Que s’est-il passé piazza Statuto en 1962 ?
C’est la seconde rupture, après Gênes en 1960. Piazza Statuto ouvre un cycle de luttes qui va culminer en 1969 avec l’Automne chaud. Il faut avoir en tête que les luttes ouvrières en Italie, en tout cas celles des années 1960 et une partie de celles des années 1970, sont rythmées par ce qu’on appelle les échéances contractuelles, c’est-à-dire la renégociation périodique des conditions de travail et de salaire dans l’usine ou dans la branche (qu’on pourrait rapprocher des conventions collectives en France). Ces « contrats » sont l’occasion de mobilisations plus ou moins rituelles, mais qui bien souvent débordent le cadre fixé par les syndicats négociateurs, au grand dam des organisations patronales.
1962 est justement une année de renégociation des contrats. Il commence à y avoir des grèves dans le Nord. Ça commence à Milan, ça se poursuit à Turin. À la Fiat, plus gros pôle industriel d’Italie – et peut-être même déjà d’Europe –, un certain nombre de syndicats signent un accord séparé. Les grévistes, furieux, sortent de l’usine, déboulent dans la ville, et donnent l’assaut au siège d’un des syndicats signataires, l’UIL 13. La gauche décrète alors quasi unanimement qu’il s’agit d’agents provocateurs, de « casseurs », de fascistes manipulateurs – voire de flics déguisés… On envoie des anciens partisans du PCI pour calmer le jeu et dire aux gens « Attention, ne cassez pas l’outil de travail ». Finalement, l’accord séparé est abandonné, mais cet épisode marque le premier terrain d’intervention visible de l’ouvrier masse.
L’ouvrier masse, c’est cet homme venu du Sud pour travailler sur la chaîne de montage, immigré intérieur, non qualifié, interchangeable. L’équivalent de ce qu’on appelait en France les O.S. (ouvriers spécialisés), qui remplacent l’ouvrier professionnel cher au PC, qualifié, syndiqué, communiste, fier de son travail et de son rôle productif. Au contraire de cet ouvrier professionnel, l’ouvrier masse affiche une indifférence totale à l’égard de ce qui est produit, et n’hésite pas à saboter, à détruire l’outil de travail.
Le siège de la piazza Statuto donne lieu à des polémiques nombreuses, par exemple entre Raniero Panzieri et Mario Tronti, à l’intérieur même du courant opéraïste. Ce débat interne va aboutir à des scissions, notamment au sein de la première revue opéraïste, les Quaderni rossi, et à la création de la revue Classe operaia.
Selon un schéma classique, Panzieri parle de « manifestation d’anarchistes sous-prolétariens », et tire le bilan de 1962 en disant que c’est un échec, que la classe en elle-même n’est pas arrivée à un niveau de maturité suffisant. Tronti, lui, renverse complètement l’analyse en affirmant qu’une nouvelle combativité ouvrière a émergé, et que c’est elle qui doit dicter la stratégie politique pour les années à venir. C’est ça, le point de vue ouvrier, partial, qui indique la stratégie… C’est en tout cas à partir du réveil des luttes ouvrières en 1962, à partir de la rupture de la piazza Satuto, que le mouvement va se développer jusqu’au point d’acmé que sera l’Automne chaud, la réplique ouvrière au 68 étudiant.
Lorsqu’on fait l’histoire de cette période, on ne parle pas de la « grève de la Fiat », mais de la « révolte de la piazza Statuto » : le lieu où la discipline syndicale signe un accord séparé contesté, le théâtre d’affrontements et de rassemblements massifs des différentes usines en grève. Ce n’est pas seulement la grève de l’usine Fiat-Mirafiori, mais aussi celle à la Lancia, à la Michelin, celle des fonderies et de l’aéronautique, de tout le tissu industriel dispersé dans la ville. La grève non seulement fédère différents pôles industriels, mais envahit aussi la ville. C’est la première grève d’usine où l’on en sort pour aller dans la rue, aux côté des ouvriers des autres usines. En s’étendant à l’échelle de la métropole, la grève répond complètement à la ville-usine qu’est Turin, avec une dissémination de l’appareil productif sur tout le territoire.
De quoi déchaîner en tous cas les commentaires de la gauche, qui refuse de voir dans les « vandales » qui font le siège du local syndical pendant trois jours les mêmes personnes que les braves ouvriers qui menaient la grève sur les contrats trois jours avant. Ce sont évidemment les mêmes, mais à partir du moment où ils sortent de l’usine, ils deviennent l’objet de tous les fantasmes.
On rencontre souvent une vision un peu linéaire de l’histoire des luttes en Italie, où les grèves d’usine des années 1960 seraient supplantées par les luttes véritablement métropolitaines à partir de 1973, où l’ouvrier-masse qui fait des cortèges internes dans l’usine précède l’ouvrier-social qui, lui, fait la révolution dans la rue. La Horde d’or, jusque dans sa composition, insiste au contraire sur les continuités, en montrant que ces luttes peuvent être métropolitaines et insurrectionnelles en même temps qu’elles sont d’usine.
On tient là peut-être l’originalité du récit proposé dans la Horde d’or : une façon de recoudre l’histoire des luttes ouvrières du début des années 1960 avec le mouvement autonome de la fin des années 1970. L’acmé de 1977 ne peut pas être isolé. Après le blackout total des années 1980, le livre est le premier geste historiographique qui, depuis l’intérieur du mouvement, tente de rétablir cette continuité. Une manière d’ouvrir un futur à ces luttes.
- Le collectif de traduction a par ailleurs mis en ligne sur son site ordadoro.info, l’intégralité du texte et des notes, ainsi que des documents, photos, et journaux élaborés au cours de la traduction. ↩
- Nanni Balestrini : Associé au mouvement littéraire Neoavanguardia, il participe dans les années 1960 à des avant-gardes poétiques comme I Novissimi et Gruppo 63, et figure aussi parmi les fondateurs du groupe opéraïste Potere operaio, en 1968. Plusieurs de ses romans ont été publiés en français : Les Invisibles (1987) et L’Éditeur (1989) (POL), ainsi que Blackout (2001), Nous voulons tout (1971), La Violence illustrée (1976) et Sandokan (2004) (Entremonde). ↩
- Marche des 40 000 : Du nombre de cadres et autres jaunes affrétés de toute l’Italie par les syndicats pour réclamer la reprise du travail après 35 jours de grève à la FIAT contre un projet de licenciement de 25 000 ouvriers. Cet épisode est généralement considéré comme le point final de la séquence de luttes de la décennie 1970. ↩
- Primo Moroni (1936-1998) : Écrivain, éditeur, fondateur de la librairie Calusca-City Lights à Milan, qui fut, à partir de sa création en 1971, le point de ralliement d’un très grand nombre de revues, coopératives de diffusion, comités de lutte, et demeure aujourd’hui parmi les rares centres de documentation sur les mouvements et la culture en Italie des années 1960 à 1990. Sur l’histoire de la Calusca, voir le Journal de traduction no 2, en ligne. ↩
- L’idéologie de la Reconstruction est le point de jonction entre le projet politique de la bourgeoisie et celui du Parti communiste italien. Elle insiste sur la nécessité de « reconstruire » l’Italie après la guerre et la chute du fascisme, pour imposer aux ouvriers d’usine de bas salaires et une forte productivité. ↩
- Le Movimento sociale italiano (MSI) est le parti néofasciste italien né en 1946, après la chute de la République sociale italienne de Mussolini et l’interdiction du Parti national fasciste par le gouvernement provisoire et les alliés. ↩
- Le terme partisan ne désigne pas forcément un membre d’un parti politique. Il peut aussi désigner divers groupes de résistants – notamment, mais pas uniquement, communistes – durant la Seconde Guerre mondiale : les Francs-tireurs et partisans français, les partisans yougoslaves, les partisans soviétiques, ou, comme ici, les résistants italiens à l’État fasciste. ↩
- Le « compromis historique » (compromesso storico) désigne le rapprochement dans les années 1970 entre deux partis historiquement rivaux : la Démocratie chrétienne, dirigée par Aldo Moro, et le Parti communiste italien d’Enrico Berlinguer, aveuglé depuis l’après-guerre par sa stratégie suicidaire de « la classe ouvrière se faisant État ». ↩
- Opéraïsme : L’opéraïsme est un renouveau de la pensée marxiste qui accompagne la vague révolutionnaire de l’Italie d’après-guerre. « Les opéraïstes faisaient de l’usine le centre du conflit. Les nouvelles générations ouvrières, leur “spontanéité”, étaient au coeur de toutes leurs analyses, ils excluaient donc toute forme d’organisation extérieure à l’usine. Ils s’opposaient aux concepts d’ “avant-garde externe”, au rôle du Parti et des bureaucraties syndicales, et privilégiaient, sur le plan tactique et stratégique, les formes d’autogestion des luttes et l’organisation autonome de base, qui allait être, quelques années plus tard, à l’origine de l’ “autonomie ouvrière”. » La Horde d’or, p. 158. ↩
- Gianni Bosio : Ancien partisan antifasciste et militant socialiste, il fonde en 1949 Movimento operaio, revue d’étude du mouvement ouvrier, dont il est exclu par Feltrinelli en 1953. Il prend alors la direction des éditions Avanti !, qui publieront la revue Il Nuevo Canzoniere italiano, en référence aux « chansonniers » sociaux de la tradition anarcho-syndicaliste antérieure au fascisme. Voir aussi en ligne « La tarantolata ne danse pas seule. Possession et dépossession dans l’ex-royaume de Naples », Entretien avec Alèssi Dell’Umbria, Jef Klak no 1, « Marabout », Automne-Hiver 2014. ↩
- Giangiacomo Feltrinelli : En 1949, le riche héritier Feltrinelli fonde l’Istituto per la storia del Movimento Operaio (Institut pour l’histoire du mouvement ouvrier) et, en 1954, la maison d’édition Giangiacomo Feltrinelli. Longtemps membre du Parti communiste italien qu’il finance, Feltrinelli entre en clandestinité en 1969. Il est retrouvé mort le 15 mars 1972, près de Milan, sous un pylône électrique, apparemment tué par l’explosion prématurée de la bombe qu’il s’apprêtait à poser. Nani Balestrini lui consacre son cinquième roman, L’Éditeur (POL). ↩
- Antonio Gramsci et Amadeo Bordiga ont tous deux participé à la fondation du Parti communiste d’Italie en 1921. Dirigée par Bordiga jusqu’en 1924, puis par Gramsci, la nouvelle formation est interdite par le régime fasciste en 1926, et Gramsci et Bordiga sont exilés sur l’île d’Ustica.
Mort en prison, Gramsci poursuit pendant ses onze ans d’incarcération de nombreux travaux théoriques sur l’histoire d’Italie, le nationalisme, les partis politiques, la littérature, le matérialisme historique, et élabore sa théorie de l’hégémonie culturelle.
Après son exclusion de l’Internationale communiste en 1930 pour « trotskysme », Bordiga animera différents partis communistes opposés au PCI et sa ligne stalinienne, notamment le Parti communiste international fondé en 1952. Le courant se réclamant de ses idées, classé à l’ultragauche et garant d’une stricte orthodoxie léniniste, est connu sous le nom « gauche italienne » (pour ses défenseurs) ou de bordiguisme (pour ses détracteurs). ↩ - Unione italiana del lavoro (UIL) : Syndicat italien fondé en 1950 à la suite d’une scission de la Confédération générale italienne du travail menée par une aile socialiste et démocrate se réclamant de l’héritage réformateur du dirigeant syndical Bruno Buozzi (assassiné par les nazis en 1944). ↩