De l’allaitement, il y a des histoires que l’on n’entend pas : les doutes, la fatigue, la culpabilité. Quatre amies me racontent.
Lire la suite

De l’allaitement, il y a des histoires que l’on n’entend pas : les doutes, la fatigue, la culpabilité. Quatre amies me racontent.
Lire la suite

C’est un poème récité, comme un rituel, pour se souvenir d’une voix et s’observer changer. Sam a 27 ans – bientôt 28. Il raconte ce que l’injection d’une hormone fait à sa vie.
Lire la suite

À 68 ans, Zébulon aime toujours manger des choux à la crème et du fromage dégoulinant. Pour lui, le risque n’est pas le trou dans la dent ni le bouchon dans la veine, mais un mauvais dosage de sucre dans le sang.
Lire la suite


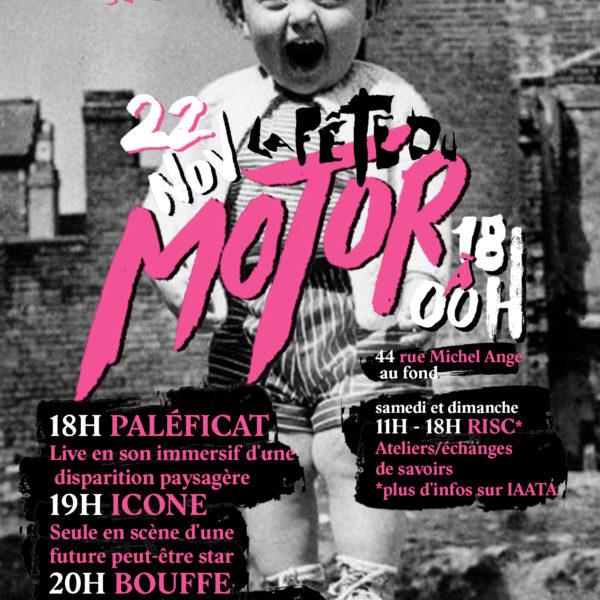

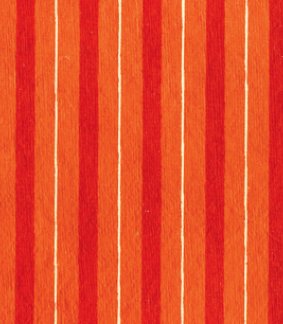
Et si le voile islamique masquait davantage la vue de celui qui le regarde que de celle qui le porte ? Professeur d’esthétique à la Sorbonne-Nouvelle (université Paris 3), Bruno Nassim Aboudrar vient de publier Comment le voile est devenu musulman (Flammarion, 2014), ouvrage qui explore la manière dont le regard travaille le monde, en islam et dans la chrétienté. Disséquant la peinture et la photographie orientalistes, l’auteur montre comment un certain regard colonial, révulsé par le voile, continue de se poser sur ce bout de tissu devenu l’image de l’islam, paradoxalement religion sans image. Ce texte est issu du numéro […]
Lire la suite

Dans le nord des Alpes, en Haute-Savoie et en Suisse romande, il n’est pas rare de faire appel aux talents d’un « leveur de mal » pour supprimer une douleur ou guérir une pathologie, jusque dans les services des urgences des hôpitaux. Efficace et discrète, cette pratique n’existe « que lorsqu’elle est mise en œuvre » ; modeste, mais tenace, elle questionne ce qu’elle ne cherche pas à expliquer. Ce texte est extrait du numéro 1 de la version papier de Jef Klak, « Marabout », paru en septembre 2014 et encore disponible en librairie. Télécharger l’article en PDF En fouillant dans mes souvenirs d’enfance, il y […]
Lire la suite

Depuis la crise argentine de 2001, le nombre d’ateliers de couture clandestins n’a cessé d’augmenter dans le centre de Buenos Aires et sa périphérie. Celui de Luis fonctionne entre autogestion et système D. Il travaille principalement pour les stylistes indépendants de la capitale qui font désormais partie intégrante de la culture vestimentaire argentine. Tout y est plus simple : les contrats de travail et les commandes sont tacites, les paiements en liquide. Revers de la médaille, cette économie souterraine qui s’est désormais généralisée en Argentine, profite surtout aux grandes chaînes du textile et à la contrefaçon, soupçonnées d’encourager le travail esclave. […]
Lire la suite