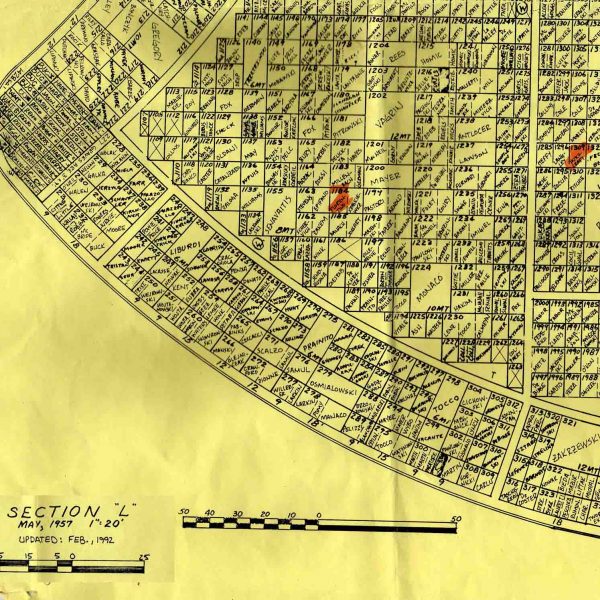Dans le nord des Alpes, en Haute-Savoie et en Suisse romande, il n’est pas rare de faire appel aux talents d’un « leveur de mal » pour supprimer une douleur ou guérir une pathologie, jusque dans les services des urgences des hôpitaux. Efficace et discrète, cette pratique n’existe « que lorsqu’elle est mise en œuvre » ; modeste, mais tenace, elle questionne ce qu’elle ne cherche pas à expliquer.
Ce texte est extrait du numéro 1 de la version papier de Jef Klak, « Marabout », paru en septembre 2014 et encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF
En fouillant dans mes souvenirs d’enfance, il y a cette histoire d’école, celle de la fille qui, tout d’un coup, « perdit » ses encombrantes verrues au visage. Ses joues devenues lisses en un week-end, elle gagna le statut de star de la récré suivante, quand elle se fit un devoir de calmer la fascination angoissée des enfants réunis autour d’elle.
Au vrai, elle ne dit pas grand-chose. Elle se contenta de confirmer qu’elle ne s’était pas fait traiter à l’azote chez un dermatologue – ce que nous voulions bien croire, car son visage ne portait nulle trace de l’opération. Puis ajouta que ses parents l’avaient amenée chez « une dame, un peu sorcière », et cela fit l’affaire.
En réfléchissant bien, il se trouve qu’un monsieur fit aussi l’affaire de la dentiste du village alors qu’elle ne parvenait pas à arrêter une hémorragie incontrôlable, qu’un autre intervint pour soigner les brûlures de deux amis, respectivement causées par un retour de flammes de barbecue au visage et une casserole d’eau bouillante renversée sur les cuisses, et qu’enfin, une dame d’un village voisin fit la mienne, d’affaire, sur le pied, alors que rien d’autre n’y faisait.
Ces dames et ces messieurs, on dit qu’ils coupent, lèvent, barrent, pansent, soufflent les maux. Le terme varie en fonction des régions. En Haute-Savoie, on utilise surtout « couper », alors qu’en Suisse romande, de l’autre côté de la frontière, ces dames et ces messieurs pratiquent « le secret ». Ils ne touchent jamais la blessure ni la personne souffrante ; ils ne sont pas magnétiseurs, ni rebouteux. On dit qu’ils ont le don, et que voilà.
« Je pouvais le faire »
Au téléphone, la femme a d’abord cru à une demande de soin, puis son mari, le charpentier, a accepté la rencontre tout en prévenant qu’il n’avait rien à dire. Ce couple habite au fin fond de la vallée du Haut-Giffre, dans un cul-de-sac formé par un cirque glaciaire, là où la route s’achève. Ce premier février, alors que je sonne à leur porte, il neige abondamment sur les chalets du village.
« Alors, quoi ? Que voulez-vous savoir ? » Installé en bleu de travail près de la cheminée, dans sa maison de bois, Jean explique qu’il y a vingt ans, un ami de son beau-père lui a transmis le don. « Pourquoi moi ? Je ne sais pas. Il a dit qu’il avait senti que je pouvais le faire. » Le charpentier « coupe » la douleur des brûlures, mais ne fait pas disparaître les blessures. « Je ne fais pas de miracles. » Pourtant, précise son épouse, « on dit que le processus de cicatrisation est plus rapide après l’intervention d’un coupeur ». Au fil du temps et de la pratique, Jean a découvert qu’il était capable de soulager, outre les blessures par le feu, « tout ce qui se rapporte à la sensation de brûlure ». Zona, herpès, coups de soleil, douleur consécutive à une radiothérapie… Plusieurs fois par jour, les demandes affluent. « Heureusement, je peux intervenir par téléphone, à distance. Il me suffit de connaître le nom de la personne, le lieu et la nature de sa douleur. » Et après ? Jean montre sa tête : « Après, j’y pense. »
Depuis le début de la conversation, l’épouse du charpentier tourne autour de la table, hésitante. D’une seule traite, enfin, elle livre son inquiétude : « Ce don, on ne sait pas d’où il vient, et le feu, une fois coupé, on ne sait pas où il va. Je suis certaine que lui, ça l’épuise. » Jean admet que la procédure le « fatigue », car elle requiert « une certaine concentration ». En revanche – et son épouse acquiesce –, il lui est impossible de refuser une demande. « Une fois qu’on a reçu le don, on se doit de le rendre. »

« Ni soigneur ni guérisseur »
« Dans cette vallée, nous sommes très nombreux à couper. C’est pareil dans la vallée de l’Arve… et dans le Chablais, je ne vous raconte pas ! Pourtant, nous n’en parlons jamais entre nous. Cette pratique n’existe que lorsqu’elle est mise en œuvre. » Catherine, institutrice à la retraite, a reçu le don de son oncle dans les années 1970, lequel « a peut-être su déceler chez moi une aptitude à l’empathie ». Depuis lors, elle coupe le feu, les hémorragies et l’eczéma, en précisant que « les formules sont différentes en fonction de ce que l’on soigne ». Comme Jean, du village voisin, elle n’a jamais volontairement ébruité son « histoire de don ». C’est en coupant que l’on devient coupeur, puis le bruit se répand. Catherine insiste : elle ne tient pas un commerce, et n’a pas besoin de publicité. « Je ne veux pas que l’on m’appelle guérisseuse. Ce que je fais est beaucoup plus modeste. C’est un service, toujours donné dans l’urgence, et gratuitement. On ne fait pas payer ce qui nous a été donné. »
D’un coupeur à l’autre, les lois et les histoires se répètent, presque invariables. Ils ont été choisis pour accueillir le don, et le transmettront à une, deux ou trois personnes – rarement davantage –, plus jeunes qu’eux, afin de perpétuer la pratique sans la disperser. L’intervention se réalise souvent par téléphone. Les demandes émanent principalement d’inconnus, et peuvent venir de loin (Bretagne, Auvergne, Paris…). Aucun n’utilise son don sur lui-même. « Nous avons, nous aussi, besoin des autres ! », explique Catherine. Ils ne demandent jamais de contrepartie financière à leur activité – mais acceptent éventuellement un cadeau – et ne peuvent refuser de soigner : « Je suis sans limites », dit l’institutrice. « C’est une ligne de conduite », ajoute Aurèle, ancien taxidermiste devenu électricien, qui confie « sursauter » à chaque appel nocturne. Depuis la campagne annécienne, à la demande d’éleveurs, ce dernier exerce également son don sur les vaches « quand elles ont des grappes de verrues sur les mamelles ». Comme l’institutrice, il précise qu’il n’est « ni soigneur ni guérisseur », puisque « ce qu’on fait, c’est lever le mal. Ça ne marche pas pour les cancers ou les leucémies. On ne guérit pas tout ».
« Se soutenir des autres »
Par chez moi, en Haute-Savoie, savoir couper, c’est plutôt banal. Ce n’est guère plus qu’une petite qualité, discrète et rapidement mise en œuvre. Les numéros de téléphone se transmettent de main en main, entre amis ou membres d’une même famille, à l’église, ou griffonnés sur un bout de papier à la boulangerie. On finit toujours par connaître quelqu’un qui connaît quelqu’un. En vrai, on ne va pas voir de coupeur de feu ; on va voir le charpentier, Aurèle, ou la mère de ton beau-frère qui coupent le feu, les verrues ou l’eczéma, et puis, au pire, ça ne fait pas de mal.
Catherine estime que son action fonctionne dans 90% des cas. Jean oublie souvent de demander le résultat, « mais les gens continuent de m’appeler, ça veut donc dire que ça marche ». Lors d’une recherche anthropologique effectuée en 1994 dans le canton suisse du Jura, Nathalie Fleury souligne la dimension collective du « secret », lequel « se soutient des autres ». Son existence repose sur une « circulation du crédit » : un résultat positif constitue une preuve renouvelée de la compétence, et la demande signifie la reconnaissance des soignés1. En 2007, Nicolas Perret, auteur d’une thèse de médecine sur les coupeurs de Haute-Savoie, observe à son tour que « ce sont les patients (…) qui transforment la potentialité du don en capacité thérapeutique ». À l’inverse d’un médecin, engagé pour soigner selon « une obligation de moyens », le coupeur est lié par une « obligation de résultats ». En bref, un « coupeur de feu qui n’est pas connu, ou reconnu, ou qui ne pratique pas, n’existe pas, même s’il possède le don2 ». En questionnant famille et amis, il apparaît d’ailleurs que certaines personnes n’activent jamais leur don, et que d’autres préfèrent nettement le refuser.
Cette petite qualité, il faut pouvoir en supporter la charge, donner de soi dans une fusion brève, intense et répétée, accepter de réciter silencieusement ce qu’il faut dire pour aspirer le « mal » de centaines d’inconnus, conserver la mèche pour qu’elle ne s’éteigne pas.
« Le secret ne soigne pas, il essaie »
Pour le feu, « plus on attend avant de couper, et moins l’on est efficace », tandis que la blessure, avant l’intervention, doit être vierge de toute action médicale – « une pommade ferait écran ». Par ailleurs, Catherine, Jean et Aurèle considèrent que le patient ne doit pas nécessairement croire en l’efficacité de la pratique pour que celle-ci opère, puisqu’ils interviennent également auprès de bébés, d’enfants et d’animaux.
« C’est une réalité qui me dépasse, confie Catherine, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne » ; « Je n’ai pas d’explication, relance Aurèle, ce qui compte, c’est le résultat. » Dans le Jura suisse, Nathalie Fleury, constate que les faiseurs de secret n’éprouvent nullement le besoin d’expliquer ou de prouver un savoir qui se manifeste uniquement comme savoir-faire. « Le secret ne soigne pas, il essaie », écrit-elle. Il n’est pas « démontrable », et les faiseurs ont d’ailleurs « du mal à le qualifier ». Certains parlent de don reçu, appris, trouvé, ou à développer ; d’autres évoquent une sorte de transfert – d’énergie, d’empathie – avec la personne souffrante3.
Il peut arriver que le mal soit « fort » ou « tenace » – pour les maladies de peau, surtout. Le don marche, ou ne marche pas, et s’il ne marche pas, on recommence l’opération à l’identique. L’acte est dans la parole – récitée silencieusement – et « c’est tout ce que l’on peut faire », considère Catherine, avant de compléter : « C’est aussi pour cela que l’on en parle peu autour de nous, car je remarque que les gens peuvent être inquisiteurs et inquiets quand ils ne comprennent pas. »
Faiseurs de secret et coupeurs de maux nient pratiquer ce qu’ils nomment « la médecine ». Ils se sentent plutôt complémentaires du corps médical qui, aux dires d’Aurèle, « n’arrive pas non plus à lever tous les maux ». À titre d’exemple, ce dernier poursuit : « Tenez, l’autre jour, le médecin du village m’a envoyé quelqu’un pour que je coupe son zona. »

« L’orateur évoque, et non invoque »
Au début des années 1980, André Julliard, ethnologue alors rattaché à l’université de Lyon, étudie les pratiques de vingt-cinq leveurs de maux du Jura français et de la Bresse, agissant principalement sur le feu, les zonas, les entorses, les verrues et les dartres. Fasciné par les travaux de Jeanne Favret-Saada sur la sorcellerie en Mayenne4, le chercheur se hasarde à rapprocher l’action de leveurs de celle des désorceleurs dans le cadre de conflits familiaux ou villageois, avant d’en revenir à une lecture plus personnelle de ses observations de terrain, radicalement différente. Comparant les leveurs de maux à des praticiens de proximité, plus accessibles géographiquement et financièrement que les professions médicales dans les campagnes, Julliard estime alors que la possession et la transmission du don ne « sauraient perturber les structures traditionnelles du village », et ne « relègue[nt] pas le guérisseur aux marges de la sociabilité villageoise », puisque ce dernier ne « devient pas sujet de crainte ou de méfiance5 ». À l’exception de ces brèves remarques sur la position sociale du leveur, le chercheur se concentre plus particulièrement sur l’aspect religieux du don.
Avoir le don équivaut à posséder, par transmission, une, deux, trois ou plusieurs dizaines de formules apprises par cœur, chacune guérissant une seule affection organique (verrues, dartres, brûlures…)6, lesquelles s’apparentent souvent à de courtes prières mettant en scène Jésus-Christ, ses apôtres, ou un saint guérisseur local, dans un combat avec une force opposée7. Associé à une « thérapie par lavage », au même titre que nombre de tisanes et de décoctions, le « don prière » cherche à refouler « une force extérieure » détenant une « vie énergétique autonome » agressant le corps humain. Au-delà des références chrétiennes de ces prières, le chercheur constate que la charge de lever le mal n’engendre « aucune altération manifeste de la croyance religieuse du guérisseur » : elle n’accroît pas la dévotion ni ne vivifie la foi, souvent moribonde, du leveur ; elle n’est pas synonyme d’initiation spirituelle ; elle n’est pas non plus comprise comme la réalisation terrestre d’une mission ou d’un pouvoir surnaturels. « Il est difficile de caractériser l’adresse à Dieu, à Jésus-Christ, ou à la Vierge Marie », remarque Julliard, puisqu’elle n’exprime aucune demande d’aide ou d’intervention. Tout au plus, « l’orateur évoque, plutôt qu’il n’invoque » le divin8.
Côté savoyard, Catherine, l’institutrice, explique qu’elle n’est « ni croyante ni pratiquante », tandis que Jean, le charpentier, se rend de temps en temps à la messe, tout en estimant que « couper le feu n’a pas de rapport avec Dieu ». Sans contredire les propos de Jean, l’écrivaine et historienne locale Colette Gérôme précise, depuis son chalet de la vallée du Giffre, qu’il existe aussi des curés qui coupent le feu, et que certains ont acquis une belle renommée en la matière.
Dans le Jura suisse, Nathalie Fleury constate que nombre de faiseurs de secret justifient leur pouvoir en invoquant leur appartenance chrétienne, tandis que les ecclésiastiques helvétiques, catholiques ou protestants, n’observent pas de position officielle face au secret, la majorité d’entre eux tolérant et acceptant cette pratique : « Ils reconnaissent la sincérité et la foi des faiseurs de secret, mais ne peuvent ou ne savent pas admettre la prétention théologique du secret9. » De même, l’abbé Giovanni, aumônier catholique rattaché aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), reconnaît des traits chrétiens au « don prière », sans pour autant doter la pratique d’une quelconque valeur religieuse. Il a récemment fait appel à un coupeur de feu, alors que la mère supérieure d’un séminaire s’était gravement brûlée avec l’huile du caquelon de l’appareil à fondue. « La peau partait avec les habits… C’était affreux. Puis, tout d’un coup, plus rien. Moi, à chaque fois qu’on ne peut pas expliquer quelque chose, je me dis “tant mieux”, car cela provoque l’intelligence. Si l’on est critique avec l’Église, autant l’être aussi avec la science ! », estime l’abbé, avant d’exhiber un numéro de la revue Science et vie intitulé « Guérir par la pensée ». « Des études ont été faites, montrant que la spiritualité – et non la religion – développait une partie du cerveau », renchérit-il.
« La mémoire orale a retravaillé le secret »
Avant, c’était mal vu.
Certains ont dû souffrir à cause du don.
Si l’on peut faire le bien, on devrait pouvoir faire
le mal, ce genre de sous-entendu, vous voyez ?
Avant, il y avait des accusations de sorcellerie,
maintenant c’est fini, tout ça.
Le don, c’est une chaîne qui vient de loin.
Je suis certaine que ça existait
bien avant le Moyen Âge.
La montagne est associée au Mal.
C’est une porte d’entrée.
Les divinités païennes ont été christianisées.
Certaines sont devenues des Vierges noires.
D’autres, des saints guérisseurs.
Ils sont installés près des sources,
des fontaines, des anciens temples.
C’est pas les Romains, c’est d’abord les Celtes.
C’est païen.
C’est païen, puis chrétien.
C’était il y a vraiment longtemps.
C’est depuis toujours.
(Extraits de mémoires d’étudiants, d’entretiens
avec des coupeurs de feu et avec une historienne locale)
Par le truchement de fortes assertions, par petites allusions ou hypothèses, la pratique du secret cherche son histoire. Pour sa part, Nathalie Fleury considère qu’il n’est pas pertinent de partir en quête des origines, forcément « floues », tout en citant de probables « influences animistes » : certaines formules mettent en scène une nature vivifiée (la lune, les arbres, la terre) côtoyant le monde chrétien. « Les faiseurs de secrets ont perdu la référence première pour ne garder que le fondement chrétien. La mémoire orale a retravaillé le secret pour ne conserver que ce qui allait dans le sens présent de l’époque. » Au regard de la puissance inquisitrice de l’Église du XVIe siècle, en lutte contre « les hérésies » dans une zone géographique alors troublée par la Réforme, « se rattacher à Dieu [était] certainement un moyen de ne pas faire disparaître les pratiques locales » et d’éviter les accusations de sorcellerie10.
En ce sens, une lettre écrite au tout début du XVe siècle par le prédicateur dominicain Vincent Ferrier, de passage en Savoie11, fait état « du paganisme » et « autres superstitions criminelles qu’il faut combattre », surtout chez les « peuples de la campagne » des diocèses de Lausanne et de Genève12. Ces observations coïncident avec les premières traces d’affaires de sorcellerie dans les archives savoyardes : entre 1411 et 1414, un homme d’Église est chargé par le diocèse de Genève de préparer une liste de personnes suspectes, de leur adresser des remontrances et, éventuellement, de les excommunier – procès et bûchers n’apparaîtront que plus tardivement. À la lecture des documents laissés par ces visites pastorales, l’historienne Hélène Viallet souligne « l’ambivalence du sorcier : jeteur de sort et guérisseur ». Ainsi, à La Balme de Sillingy, proche d’Annecy, Agathe, femme de Girard Rivilliod, et Jeannette Reine, sont accusées de sorcellerie car elles « ont coutume de guérir certaines infirmités par des paroles magiques ». De même, à Chapeiry, en Haute-Savoie, une autre Jeannette, femme de Pierre Majorier, est suspectée de pratiquer, outre la divination, la médecine « par les mots13 ».
Quelques décennies plus tard, Eynarde Fournier, une vieille dame vivant dans le Grésivaudan (entre Grenoble et Chambéry), accepte de réciter, lors de son procès, la prière qu’elle utilise pour « souffler » le feu des mauvaises fièvres. Évoquant les actions purificatrices de la pierre et de l’eau avant de s’en remettre à la Sainte Trinité, la prière est tout de même considérée diabolique par le notaire14.
« La liste est dans l’armoire de l’hôpital »
Maintenant assise face à la cheminée, l’épouse de Jean, le charpentier, parle tranquillement. Elle estime que l’attitude des médecins vis-à-vis des coupeurs a beaucoup changé en l’espace de quarante ans : « Ils ne pensent plus forcément qu’il s’agit d’une connerie, et sont devenus plus tolérants. Récemment, un médecin a demandé s’il pouvait nous envoyer des patients. On a décliné la proposition, car avec le bouche à oreille, ça faisait déjà beaucoup ! » Catherine, quant à elle, a souvent collaboré avec le médecin de son village, jusqu’à ce que ce dernier prenne sa retraite il y a peu. Prudente, elle n’ose se présenter au nouveau praticien, car elle ne sait pas trop « ce qu’il en pense ». Les techniques de soin dites populaires continuent d’entraîner des « réponses défensives » et une « profonde agressivité », comme l’écrit Benoite Denis dans sa thèse de médecine, soutenue à Angers en 2010 ; la jeune femme se réfère notamment à la réaction d’un collègue, lequel « déclare que s’il apprenait qu’un de ses patients, traité pour un zona, consultait parallèlement un coupeur de feu, il le sommerait fermement de lui rendre son Zelitrex15 ! ».
En dépit de réactions parfois négatives, les coupeurs de maux suscitent, depuis une vingtaine d’années, l’intérêt des étudiants en médecine et en formation de soins infirmiers. En 2005, par exemple, la docteure Marina Gaimon réalise, dans le cadre de sa thèse, une enquête sur les motivations et satisfactions de patients ayant consulté un guérisseur dans le Berry, en particulier pour traiter les brûlures et les pathologies dermatologiques16. Et, si l’on s’en tient à la Haute-Savoie et à la Suisse romande, une dizaine de travaux portent exclusivement sur les collaborations entre institutions de soins et coupeurs de maux, après que deux apprenties infirmières ont ouvert le bal dans le Jura suisse en 1993. Entre-temps, une réforme des études médicales à Genève en 2000, puis à Lausanne en 2009, a introduit un stage obligatoire « d’immersion en communauté », lequel encourage les élèves à travailler sur « la multitude d’aspects [d’un processus de soin] qui sortent du cadre strict de la relation médecin-malade et du processus de diagnostic et de traitement17 ».
Face à la présence de listes de coupeurs de feu, actualisées par les soignants, dans les services des urgences de plusieurs hôpitaux des cantons suisses de Genève, de Vaux ou du Valais, les étudiants s’interrogent donc. « Comment se fait-il que l’hôpital, où règne en maître l’Evidence-based medecine18, ait laissé une place, quelle qu’elle soit, à des praticiens dont le mode d’action peut faire penser à un rituel magique, ancestral, et certainement difficile à admettre pour tout esprit cartésien ? », écrivent Sophie Martinelli, Victoria Pozo et Juliet Zingg en introduction de leur mémoire de licence. Ces trois infirmières ont réalisé des entretiens avec le personnel des urgences de l’hôpital universitaire de Genève en 2011, où une liste est accrochée « à l’intérieur d’une armoire », et où l’on est bien incapable d’expliquer « comment la liste est arrivée là ». Comme ailleurs, en Haute-Savoie ou en Suisse, cette feuille de papier ne mentionne que des coupeurs de feu appelés pour réduire les douleurs des brûlures. À l’issue de leur enquête, les trois jeunes femmes estiment que l’existence de ces pratiques soulève bien plus de questions sur le « sens de la biomédecine et le rôle des soignants » que sur leur « simple efficacité thérapeutique ».
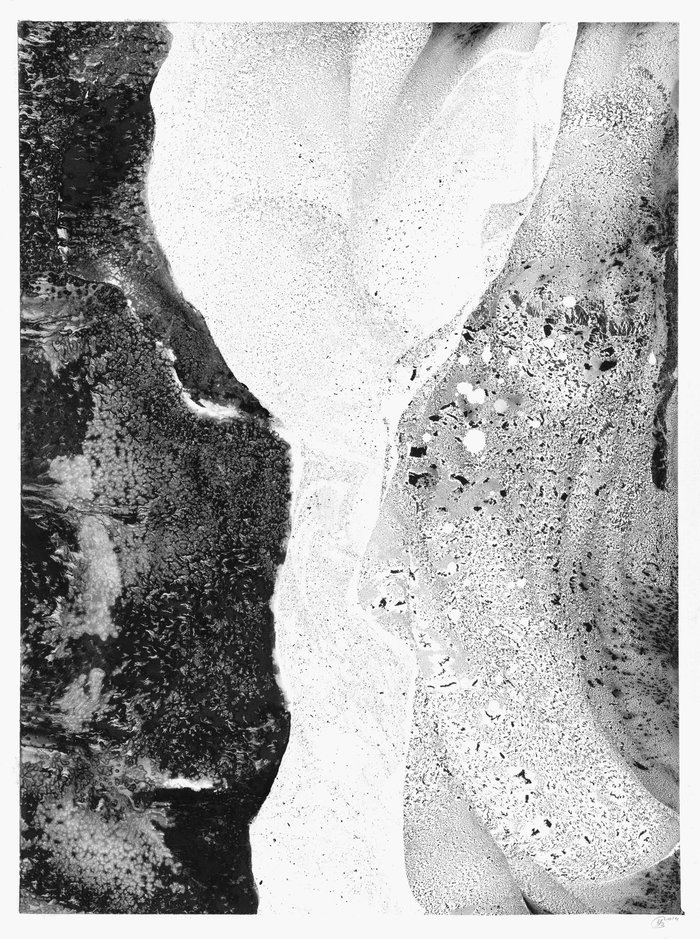
« Le standard a failli exploser »
À Thonon-les-Bains, aux abords du lac, la secrétaire d’un service de gériatrie des hôpitaux du Léman indique, avec un sourire, que « la chef de service sera disponible pour répondre de sa seconde spécialité une fois qu’elle aura achevé ses visites médicales ». Ancienne responsable du service des urgences, la docteure Danièle Tavernier est une interlocutrice de choix en matière d’intervention de coupeurs de feu dans l’hôpital. Originaire de la vallée du Rhône, elle a étudié à Lyon, avant d’effectuer son internat à l’hôpital de Sallanches, en Haute-Savoie, puis de prendre la direction du service des urgences de Thonon, il y a une vingtaine d’années. Installée dans son bureau, elle explique combien elle fut stupéfaite, au début de sa carrière, de constater que le personnel infirmier appelait des barreurs de feu en cas de brûlures. « J’étais complètement en opposition avec l’équipe. Je passais mon temps à leur expliquer que nous avions appris des techniques pour soigner les brûlures, et que nous n’avions pas besoin de ça. » Jusqu’au jour où elle reçoit deux très grands brûlés, lesquels expliquent ne plus ressentir de douleurs suite à l’action de coupeurs de feu. Au Centre de traitement des brûlés de Lyon, les soignants constatent, dans les deux cas, une cicatrisation anormalement rapide, ne laissant aucune trace.
Perplexe, Danièle Tavernier admet la technique dans son service, « uniquement dans les cas de brûlures, quand les gens disent qu’ils ont mal », jusqu’à accepter de témoigner de l’efficacité de cette pratique lors de deux émissions télévisées, accompagnée du coupeur de feu attitré de l’hôpital. « Alors même que la première émission était en cours de diffusion, le standard de l’hôpital a failli exploser – j’avais fait l’erreur de dire où je travaillais. Cela a duré six mois ! », poursuit la médecin. Des coupeurs de feu appellent pour proposer leur service depuis la France entière, d’autres personnes téléphonent pour exprimer leur désaccord. « J’ai même reçu un appel d’insulte de l’Ordre des pharmaciens ! Ils devaient craindre pour les ventes de pansements gras », s’indigne encore l’ex-cheffe de service, alors que cette dernière a toujours insisté sur le fait qu’elle n’altérait pas sa propre pratique de soin.
« Une leçon populaire ? »
À Sion, en Suisse, une liste existe depuis dix-sept ans. Dissimulée derrière un panneau, « elle ne porte pas l’en-tête de l’hôpital », précise le médecin-chef des urgences. En Haute-Savoie, à l’hôpital d’Annecy, le protocole de prise en charge des brûlures mentionne, en nota bene, la possibilité de faire appel à un coupeur de feu, avec l’accord du patient, tout en précisant que cela « ne doit en aucun cas retarder les soins traditionnels », et fournit une série de coordonnées.
De chaque côté de la frontière, la pratique reste soumise à son acceptation, souvent tacite, par le chef de service. Jamais véritablement officielle, et pas tout à fait officieuse, l’intervention des coupeurs de feu constitue la seule technique de soins dite parallèle tolérée au sein des hôpitaux du territoire alpin, sur proposition du personnel soignant ou à la demande du patient. « Serait-ce parce qu’il s’agit d’une technique rapide, gratuite, souvent opérée à distance [par téléphone] ? (…) Une technique où l’on n’aurait rien à perdre d’essayer ? », questionnent les trois infirmières dans leur mémoire. Quelle que soit la réponse, cette collaboration renforce, pour ces dernières, la qualité des soins, notamment parce la « croyance », la « culture » et l’« accord du patient [prennent] une place plus importante en comparaison avec les soins usuels dans l’hôpital ». Elles soulignent, enfin, un intérêt, une curiosité et une ouverture pour cette pratique plus forts de la part du personnel infirmier que de celle des médecins.
À l’occasion de sa thèse de médecine, Nicolas Perret a poussé l’enquête un peu plus loin, à partir des services des urgences des hôpitaux d’Annecy, d’Annemasse et de Thonon-les-Bains. Après avoir interrogé 134 soignants et 173 patients brûlés, ce dernier a obtenu des taux de satisfaction très élevés : 70% des soignants constatent que l’efficacité des coupeurs sur la douleur est forte ou totale, 81% d’entre eux estiment la collaboration entre services de soins et coupeurs de feu souhaitable ou indispensable, et 80% des patients ont vu leur douleur réduite d’au moins 30%. « On peut au moins dire que l’effet placebo assure des résultats. Mais, que dire à propos de l’intervention sur une personne qui n’y croit pas, ou bien qui n’est pas au courant, ou encore sur des animaux ? Là, je n’ai plus aucune réponse », confie ce jeune médecin, qui se demande si l’action des coupeurs de feu ne constituerait pas « une leçon populaire pour notre technocratie » ? D’un haussement d’épaules, Aurèle, l’ancien taxidermiste, pense que « parler d’effet placebo, c’est une manière de se rassurer ».
Illustrations : Tellurismes (Encres de chine sur papier, avril 2014, 56 x 76 cm) de Yann Bagot.
- « Le secret dans le canton du Jura. Approche anthropologique d’une pratique de guérison », Recherches et travaux en anthropologie, nº 8, 1994. ↩
- Perret Nicolas, « Place des coupeurs de feu dans la prise en charge ambulatoire et hospitalière des brûlures en Haute-Savoie en 2007 », thèse de doctorat, faculté de médecine de Grenoble, 2007. ↩
- Fleury, op. cit. ↩
- Voir Jef Klak no 1, « Marabout », p. 59, « Être fort assez, la sorcellerie dans le Bocage ». ↩
- Cf. Julliard André, « Le don du guérisseur. Une position religieuse obligée », Archives de sciences sociales des religions, 54/1, 1982. ↩
- La récitation des prières peut éventuellement s’accompagner d’une gestuelle (signe de croix, souffle, etc.). ↩
- On en trouve des exemples dans les almanachs paysans, dans les livres de médecine populaire, chez les folkloristes régionaux ou sur Internet – de toute évidence, jamais les coupeurs ne livrent leurs secrets. ↩
- Julliard André, « Dons et attitudes religieuses chez les leveurs de maux en France (1970-1990) », Marges contemporaines de la religion, Religiologiques, nº 18, 1998. ↩
- Fleury, op. cit. ↩
- Ibid. ↩
- Au XVe siècle, le duché de Savoie s’étendait de l’actuelle Suisse romande jusqu’à Nice. ↩
- Lettre écrite de Genève le 17 décembre 1403, citée par Hélène Viallet dans « Sorcellerie et déviances en Pays de Savoie du XVe et XVIIe siècle », La revue savoisienne, vol. 139, 1999. ↩
- Viallet, op. cit. ↩
- Cf. Pierrette Paravy, « Prière d’une sorcière du Grésivaudan pour conjurer la tempête », Le monde alpin et rhodanien, 1982. ↩
- Traitement antiviral.Benoite Denis, « La médecine populaire des poussées dentaires : approches biomédicale, anthropologique et psychanalytique », thèse de doctorat, faculté de médecine d’Angers, 2010. ↩
- Marina Gaimon, « Étude des motivations et des satisfactions des patients d’un secteur rural ayant consulté un guérisseur », thèse de doctorat, faculté de médecine de Tours, 2005. Cette dernière rapporte des taux de satisfaction extrêmement élevés. ↩
- Cf. Présentation du stage obligatoire d’« immersion en communauté », faculté de médecine de Genève, www.medecine.unige.ch. ↩
- Médecine fondée sur des preuves, ou médecine factuelle : paradigme scientifique cherchant à prouver, au moyen d’essais cliniques, le degré d’efficacité d’un traitement thérapeutique. ↩