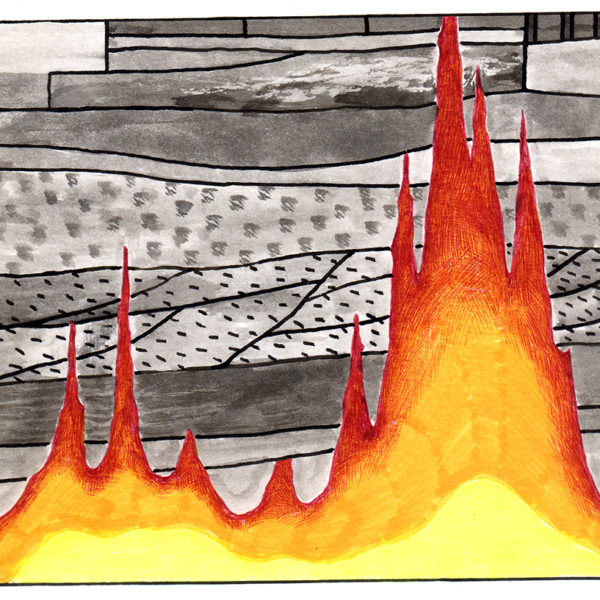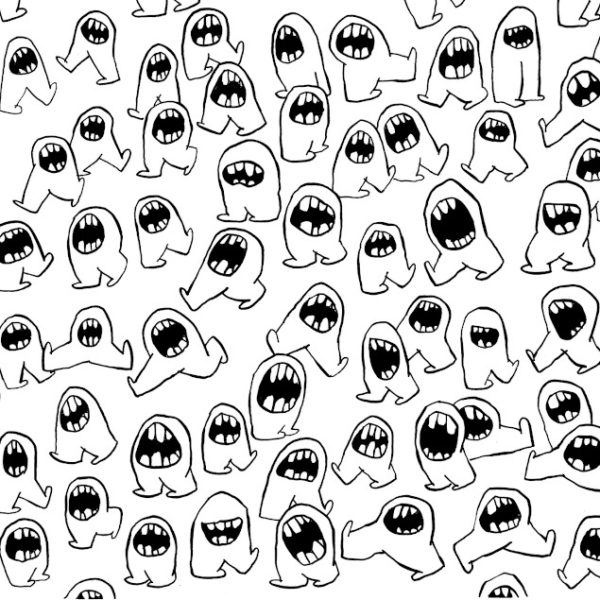Crédits photos : Yann Lévy / Hans Lucas
Du 16 au 18 mai 2018 aura lieu le procès en appel de trois policiers condamnés pour avoir blessé six personnes à Montreuil le 8 juillet 2009, et mutilé l’une d’entre elles. Le collectif 8 juillet travaille depuis neuf ans à porter la vérité des violences subies sur la place publique. Surtout, il s’agit de montrer le fonctionnement devenu banal des forces de l’ordre dans les banlieues, les ZAD, les manifestations, les camps de réfugié·es ou le simple quotidien : entre brutalité froide et impunité systémique. Pour un rappel des faits et de la procédure qui a permis de faire passer en justice la police, on pourra lire sur le site de Jef Klak un long entretien avec les membres de ce collectif, composé de personnes blessé·es par la police et de soutiens. Aujourd’hui, avant le procès en appel, Jef Klak publie par paire les témoignages de la première instance et donne la parole au collectif 8 juillet.
*
« Le 16 décembre 2016 au TGI de Bobigny, trois policiers ont été condamnés pour s’être adonné à une partie de Flash-Ball le soir du 8 juillet 2009 à Montreuil, et avoir blessé six personnes, mutilant l’un d’entre nous. Non contents des peines pour le moins symboliques dont ils ont écopé 1, les policiers ont fait appel, prolongeant encore une procédure sans fin.
Les sept années qui ont précédé ce premier procès, nous avons rencontré de nombreux collectifs constitués suite à une blessure, à un mort. Partageant nos histoires, nous avons acquis une connaissance précise des mécanismes de la violence policière. Nous avons les pleurs, mais aussi l’expérience, nous avons la rage, mais aussi le savoir. Nos vécus, nos luttes ont fait de nous des expert·es.
Le mercredi 24 et le jeudi 25 novembre 2016, c’est cette expertise sensible que nous avons convoquée à l’intérieur du tribunal. Il n’était plus question pour nous de demander la vérité, mais de la faire surgir depuis le réel de nos histoires, et de l’imposer là où elle est continuellement effacée et déniée. Treize personnes directement touchées par la violence policière sont venues témoigner à la barre, et voici deux de ces prises de parole… »
Collectif 8 juillet
*
Le procès aura lieu à la Cour d’appel de Paris, métro Cité, pôle 2 chambre 7, les après-midi du 16, 17, 18 Mai 2018.
Contact : huitjuillet (at) riseup.net
Télécharger le dossier de presse complet en PDF.
Télécharger l’article en PDF.

11 février 2017 : près de 2000 personnes se sont rassemblées à Bobigny pour soutenir Théo et dénoncer les violences policières. Photo Yann Lévy / Hans Lucas
*
« Il existe un hiatus énorme entre la police et les quartiers populaires »
Omar Slaouti, Vérité et Justice pour Ali Ziri
Je suis enseignant. J’habite Argenteuil. C’est dans cette ville que M. Ali Ziri, âgé de 69 ans, est décédé suite à son interpellation par la police d’Argenteuil. Je viens témoigner aujourd’hui parce qu’au bout de sept ans de procédure, les conclusions ont créé beaucoup d’amertume dans ma ville – dans ces fameux quartiers populaires dont on parle souvent. Le verdict a été un non-lieu.
Un non-lieu ne veut rien dire en soi . Mais quand est écrit noir sur blanc: « La force dont a usé la police était proportionnée », un tel non-lieu signifie qu’il n’y a pas eu dysfonctionnement dans la technique d’interpellation de M. Ali Ziri, qu’il n’y a pas eu d’anomalie. Ce qui signifie mécaniquement que cette situation peut se renouveler.
Je voudrais préciser à la cour que cet homme âgé de 69 ans était retraité, et qu’il avait croisé ce jour-là un ami, âgé de 61 ans, également retraité et handicapé à 60 %. Ces deux messieurs avaient certainement bu plus que la moyenne. Leur véhicule n’allait pas tout droit. On les a donc interpellés. Jusque là rien d’anormal. Sauf que ces deux messieurs, alors qu’ils étaient menottés dans le dos, ont subi des coups. Ceci sans le moindre doute, comme en témoignent l’ensemble des stigmates sur le corps de M. Ali Ziri. 48 heures après son interpellation, il va décéder, et on retrouvera sur son corps 27 hématomes, dont un de 17 centimètres de diamètre au niveau dorso-lombaire.
L’affaire est classée sans suite très rapidement. La famille a porté plainte, et une nouvelle expertise médicale est demandée auprès de l’institut médico-légal. Le professeur Leconte, une sommité en la matière, fait le lien entre la technique d’immobilisation sur M. Ali Ziri dans le véhicule de police – une technique de pliage interdite en France depuis 2003 mais encore en usage dans la police française – et une hypoxie, une anoxie et secondairement, un arrêt cardiaque. Ceci est extrêmement important, parce que dans cette affaire, il va y avoir plusieurs expertises médicales. Sur quatre, trois d’entre elles vont confirmer une hypoxie suite à la technique d’immobilisation. La première, quant à elle, suppute une cardiomyopathie, comme le mettent souvent en avant les procureurs, par exemple dans l’affaire d’Adama Traoré 2. Dans notre affaire, le juge d’instruction va conclure à un non-lieu, malgré le fait que les parties civiles, y compris le ministère public, ont demandé une enquête supplémentaire.
Il existe un hiatus énorme entre la police et les quartiers populaires. Les policier·es présent·es ici savent de quoi nous parlons. Les gens qui vivent dans des quartiers populaires savent aussi de quoi nous parlons. Ils le savent d’autant plus qu’ils le vivent au quotidien. Les policier·es ont voté à plus de 70% Front national aux dernières élections régionales. Il y a un problème structurel dans cette police, et dans ce pays. Mais c’est d’autant plus grave quand ça concerne la justice.
Dans l’affaire Ali Ziri, les parties civiles ont demandé quatre éléments supplémentaires pour pouvoir faire l’instruction à charge et à décharge : que le juge d’instruction entende personnellement les témoins, ainsi que les policiers impliqués dans l’arrestation, qu’il effectue une reconstitution, et enfin que puisse être visionnée en présence des témoins la caméra nº 7 située face au commissariat d’Argenteuil. Le juge d’instruction a répondu qu’il n’était pas question de visionner cet enregistrement en présence des témoins, parce que cela risquerait d’altérer leur sincérité. Or ces témoignages ne sont dans le dossier que sous forme de procès-verbaux établis par la police. Jamais le juge d’instruction n’a confronté les différents témoins. Peut-on juger de la fiabilité de ces témoignages lorsque seule la police enquête sur la police ? La Cour des comptes s’interrogeait déjà en 2010 sur la fonctionnalité de ce type de système.
La Cour d’appel confirme le non-lieu. Nous allons alors en Cour de cassation, qui conclut que la décision du juge d’instruction n’a pas été « légalement motivée ». Elle explique qu’il n’est pas normal que ces quatre demandes n’aient pas été accordées. Nous retournons donc à la Cour d’appel de Rennes, qui rend de nouveau un non-lieu, confirmé cette fois-ci par la Cour de cassation en février 2016. Nous avons depuis saisi la Cour européenne des droits de l’homme, qui vient de nous accorder la recevabilité de notre dossier. L’État français devra répondre des agissements de ces policiers.
Mais ce qui est important dans cette affaire est que nous avons eu à faire à une procédure particulièrement malhonnête de la part de ceux qui ont instruit ce dossier. On ne peut pas juger correctement une affaire à charge et à décharge, si on décide de rendre aveugle des caméras, si on décide de mettre de côté des pièces fondamentales pour la justice et la vérité, comme il est écrit sur de nombreux T-shirt en mémoire d’Adama Traoré ou Amine Bentounsi 3, ou de tous ceux et toutes celles mutilé·es par la police.
Les notions de vérité et de justice sont souvent clamées dans un mégaphone, sur une banderole, ou dans des manifestations. Elles marquent les manquements de la justice. Je tiens à dire qu’en tant qu’enseignant, j’ai affaire à ces populations de jeunes où l’aigreur est parfois très importante à l’égard des institutions. Mon rôle est un rôle de distanciation, je ne prends jamais position. Mais je témoigne personnellement, entre moi et moi, de ce ressentiment extrêmement fort que peuvent avoir des jeunes et des moins jeunes dans des quartiers populaires souvent délaissés, que certain·es rapprochent de véritables zones d’apartheid. Lorsque socialement on est mis de côté, et lorsque juridiquement, ni la police ni la justice ne peuvent être un recours pour garantir et obtenir une dignité égale pour tous, cela devient vraiment compliqué.
M. Ali Ziri était un ami de mon père. Je le dis avec une pointe d’émotion, car j’ai rarement vu mon père pleurer. Pour des milliards de raisons, liées notamment à son histoire personnelle. Mais ce jour-là, sans me regarder dans les yeux, par dignité, le regard embué, il m’a dit : « Ça recommence. » Dans la bouche de mon père, qui n’est franchement pas quelqu’un de particulièrement énervé, « Ça recommence » signifiait qu’il y a des relents qui remontent à une certaine idée de la police : celle qui jetait les Algériens dans la Seine le fameux 17 octobre 1961. Pour mon père, qui a 85 ans, c’était la référence.
Comment un monsieur de 69 ans et son ami de 61 ans, menottés dans le dos, ont pu constituer un quelconque danger à l’égard de ces trois policiers ? Il y a aujourd’hui un dysfonctionnement clairement établi de la police. La police s’organise, se structure. Les policier·es discutent entre eux. Les syndicats de police font parfois pression sur la police des polices. Ils sont même capables de manifester en dépit du droit. Amnesty International parle même de « policiers au dessus des lois ». La vraie question qui se pose est : dans quelle mesure la justice est-t-elle réellement indépendante des pressions policières ? Je le dis particulièrement pour ce juge d’instruction qui a décidé d’un non-lieu, alors que le procureur estimait qu’il fallait poursuivre l’enquête jusqu’au bout.
Ce sont ces dysfonctionnements qu’on vient aujourd’hui mettre en exergue. Et sans grande fierté, je vous dis que nous avons très peu d’espoir dans les affaires de justice, et que si les pots de terre que nous sommes peuvent difficilement gagner contre vos pots de fer, il se pourrait qu’à force de nous briser, nous finissions par vous ensevelir.

11 février 2017 : près de 2000 personnes se sont rassemblées à Bobigny pour soutenir Théo et dénoncer les violences policières.Photo Yann Lévy / Hans Lucas
*
« La police s’est retrouvée devant des habitant·es qui refusaient ce qu’il se passait »
Dabo, ancien membre du Collectif de Montreuil
pour les droits des sans-papiers
Je m’appelle Dabo. Je suis là aujourd’hui pour raconter ma vie de sans-papiers à Montreuil à l’époque des faits. Quand je suis arrivé à Montreuil, j’ai habité dans un foyer de travailleur immigré censé accueillir 420 personnes, mais en réalité, nous étions 1200. En arrivant en France, ce qui m’a frappé est de ne plus avoir d’identité. Face à cela, j’ai essayé de rencontrer des personnes qui étaient dans la même situation ,et aussi des gens qui pouvaient me soutenir. J’ai rencontré le collectif de Montreuil pour le droit des sans-papiers, créé en 1997 suite à l’expulsion de l’église Saint-Bernard. J’ai fini par adhérer à ce collectif parce qu’on y partageait les mêmes rêves de liberté. Il y avait aussi une permanence juridique hebdomadaire le samedi, qui aidait à faire des recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière et à constituer des demandes de régularisation auprès de la préfecture. J’ai aussi été obligé de trouver un autre logement que le foyer. À 32 ans, je dormais dans le couloir du foyer par défaut de place. J’ai donc occupé une maison vide dans laquelle j’ai habité pendant sept ans.
À l’époque, il fallait attendre 10 ans en France pour avoir la possibilité d’être régularisé. Pendant ce temps, il fallait espérer ne pas être expulsé. En 2006, le gouvernement a mis en place le Code d’entrée de séjour des étrangers et des demandeurs d’asile (Ceseda), qui a empêché toute possibilité pour les étrangers et étrangères d’être régularisé·es. Cela s’est ressenti à Montreuil. Tous les jours, partout, il y avait des arrestations, surtout aux alentours des foyers, où il y avait aussi des perquisitions. Je connais des gens avec qui j’ai passé du temps, qui un jour sont sortis pour aller prendre le métro ou acheter leur baguette et ne sont jamais revenus. On les a retrouvés au centre de rétention ou au Mali. C’est à ce moment que j’ai pris conscience qu’on avait tout perdu. En arrivant en France, on vient avec l’espoir qu’on va s’en sortir. C’est cet espoir qui s’est envolé pour moi ce jour-là. Je ne pouvais plus sortir de chez moi. Je ne pouvais plus rencontrer qui que ce soit. On pouvait se faire arrêter à n’importe quel moment.
À Montreuil, il y a sept foyers de travailleurs immigrés. La police pouvait facilement « faire du chiffre » en matière d’arrestations de sans-papiers. Face à ça, des habitant·es de Montreuil et le collectif de Montreuil pour les droits des sans-papiers ont créé un groupe pour prévenir les sans-papiers en cas de contrôle de police. On a créé l’Assemblée contre les expulsions. Il y avait des personnes qui venaient de tous les bords, de partis politiques, de syndicats, d’associations et des habitant·es de la ville de Montreuil. La première initiative a été de rédiger un tract qui expliquait ce qu’il faut faire en cas d’arrestation ou d’expulsion. Puis, l’assemblée a décidé aussi de faire une déambulation tous les mercredis à Montreuil. Le rendez-vous était donné devant un foyer de la ville pour aller vers un autre, etc. Ça permettait d’expliquer aux gens qui ne voyaient pas ce qu’il se passait pour nous, d’être informés.
Le 4 juin 2008, le départ était donné devant le foyer Rochebrune. Une heure avant, deux personnes ont été arrêtées : la première dans une cabine téléphonique à la sortie du foyer, elle appelait sa famille en Afrique. La seconde sortait du foyer pour aller jouer au foot avec ses camarades. Des gens du foyer nous ont appelé·es et on est venus discuter avec les gens qui avaient assisté à ces arrestations. Ils nous ont répondu que la police était de passage, et qu’elle les avaient contrôlés et embarqués. Nous étions une vingtaine et nous avons décidé d’aller au commissariat pour demander la libération de nos camarades. En arrivant devant le commissariat, les policiers sont sortis armés, avec des matraques et des chiens. Ils et elles se sont mis à nous pousser, nous ont frappé·es et nous ont tiré dessus au Flash-Ball. Deux personnes ont été blessées. Parmi la vingtaine de personnes qui étaient là, il y avait une dizaine de sans-papiers. La seule chose que nous pouvions faire ce jour-là, c’était essayer de se sauver.
Entre-temps, la maire de Montreuil est venue devant le commissariat pour discuter avec la police. Elle nous a dit que la violence à laquelle elle avait assisté n’était pas justifiée. Il y a eu parmi nous plusieurs arrestations. En même temps, au moins 300 personnes se sont rassemblées devant le commissariat après avoir appris ce qu’il s’était passé, pour demander la libération des gens arrêtés. Tous ceux qui avaient des papiers ont été libérés. Trois personnes qui n’avaient pas de papiers ont été gardées. On a appris par la suite que l’une d’entre elles avait été grièvement blessée au Flash-Ball au niveau des testicules et qu’une autre avait eu un problème asthmatique. Les pompiers sont intervenus. La scène avait été filmée par une personne qui s’est aussi fait arrêter. Cette personne a été jugée quelques mois plus tard. Elle a été condamnée à payer 1000 euros d’amende pour violence sur agent alors qu’elle ne faisait que filmer. Les trois sans-papiers ont été gardés à vue pendant 48 heures. Ils sont aussi passés en procès et ont été relaxés pour les faits de violence sur agent. Entre-temps, la CNDS 4 a sorti un rapport attestant qu’il n’y avait pas eu de violence de la part des manifestant·es. En revanche, ce rapport a mis en avant que la police avait utilisé tous les moyens pour faire, de son côté, usage de la violence.
Si je vous raconte tout ça aujourd’hui, c’est pour vous dire que lorsque je suis arrivé en France j’avais un rêve, j’avais de l’espoir. Lorsque la loi Ceseda est passée en 2006, il n’y avait plus ni espoir, ni rêve. L’image de la France depuis l’Afrique est celle d’une terre d’accueil. Nous rêvions d’être ici parce que nous pensions y trouver de la liberté et de la justice. Mais en arrivant, on est devenu sans-papiers, on a perdu notre identité. On nous a poussé vers le faux. J’ai été sans-papiers et la réalité, c’est que nous devions aussi aller travailler pour pouvoir vivre. Nous ne sommes payés que 5 euros de l’heure. Et si les sans-papiers sont toujours là, c’est parce qu’on a besoin d’eux. On les laisse utiliser les papiers d’autres personnes. On les laisse cotiser à la Sécurité sociale. Mais on ne leur laisse pas le droit d’exister. Lorsque j’ai occupé une maison, ce n’était pas pour le plaisir. Il fallait que je trouve un endroit où dormir, sinon je mourrais dehors. Le passage de la loi Ceseda en 2006 m’a bouleversé. Comment peut-on assister à des rafles en 2006 ? Des camions entiers ont été remplis de noir·es et d’arabes qui se sont retrouvé·es en centre de rétention.
Je l’ai personnellement vécu. Et aujourd’hui, j’ai l’occasion d’être devant vous pour vous raconter ce que j’ai vécu. Jusqu’à aujourd’hui, les seules fois où je me suis retrouvé devant un juge, c’était sous la menace d’être amené en centre de rétention ou reconduit à la frontière. Par chance, je n’ai jamais été expulsé.
Pour moi ce qui s’est passé ce 4 juin à Montreuil, est le reflet de la politique de l’État. À l’époque, l’objectif de 30 000 expulsions par an avait été fixé. À Montreuil, il y a beaucoup de foyers. Beaucoup d’immigré·es habitent Montreuil. La police applique la loi et y met tous les moyens. Seulement, là, la police s’est retrouvée devant des habitant·es qui refusaient ce qu’il se passait. Ce jour-là, la police voulait sans aucun doute provoquer les gens en arrêtant des sans-papiers devant le foyer, juste une heure avant l’appel d’une manifestation contre les rafles et les expulsions… Lorsqu’on est arrivé devant le commissariat, ce n’était pas pour en découdre. Nous n’étions qu’une vingtaine et parmi nous, une dizaine de sans-papiers. La police était déjà prête et bien équipée. Comme s’ils nous attendaient…
Après cette histoire, la répression a continué. En tant que sans-papiers, on ne sait plus comment se comporter avec les gens. On devient marginal. Je suis en France depuis 17 ans et j’ai toujours l’impression d’être arrivé hier. Tout est fait pour nous rappeler que nous ne sommes pas chez nous. La preuve en est ce qu’il s’est passé lundi matin, quand je suis arrivé au Palais de justice. L’agent de sécurité me bloque. J’essaie de lui expliquer que je suis témoin dans ce procès. Deux policiers avancent vers moi. L’un d’eux me pousse. Je redis que je suis convoqué pour témoigner. L’agent me demande ma convocation. Mais même en l’ayant lu, il ne pouvait pas se raconter que, moi, un étranger noir, je puisse être convoqué pour témoigner dans ce procès. Il m’a remis ma convocation en me disant qu’il ne pouvait pas s’agir de ce procès. Seule l’intervention de mes camarades pour dire que nous étions tous ensemble, m’a permis de passer. Et lorsque je suis sorti, pendant le rassemblement devant le tribunal, un agent de sécurité est venu me retrouver pour s’excuser en disant que lui venait du Sénégal et moi du Mali. Ce qui m’a choqué, c’est qu’il ait pris le temps de lire ma nationalité et ma date de naissance, mais pas l’objet de ma présence. Il ne pouvait pas admettre que je vienne témoigner dans ce procès. Qu’est ce que ça raconte ?
Je peux vous raconter des histoires comme ça jusqu’à demain. Mais même demain, ce sera encore comme ça. Pourtant je suis content d’être venu devant vous, vous raconter ce que j’ai vécu pendant ces années en tant que sans-papiers.
- Condamnations pour violence par personne dépositaire de l’autorité publique : 15 mois de prison avec sursis et 18 mois d’interdiction de port d’arme pour le gardien de la paix Le Gall, 10 mois avec sursis et 12 mois d’interdiction de port d’arme pour le brigadier Gallet et 7 mois avec sursis et 12 mois d’interdiction de port d’arme pour le gardien de la paix Vanderbergh. Aucune interdiction d’exercer n’a été retenue malgré les réquisitions du procureur. Quant aux indemnisations, le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé la décision au tribunal administratif. ↩
- En juillet 2016, Adama Traoré meurt à la gendarmerie de Persan, à la suite de son interpellation à Beaumont-sur-Oise. Deux expertises médico-légales de son corps ont lieu, contestant les marques de violences pourtant constatées par les pompiers l’ayant pris en charge, mais se contredisant quant à l’existence d’une cardiopathie à l’origine de sa mort. La demande de la famille d’une troisième contre-expertise a été rejetée par le juge d’instruction. ↩
- En 2012, Amine Bentounsi, pour ne pas être retourné en prison après une permission, était tué d’une balle policière dans le dos à Noisy-le-Sec. Son meurtrier, le gardien de la paix Damien Saboundjian, affirmant avoir tiré en légitime défense, a été acquitté en première instance, mais condamné en Appel à cinq ans de prison avec sursis, notamment grâce à l’acharnement de sa sœur Amal, membre du collectif Urgence la police assassine. ↩
- La Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) était une autorité administrative indépendante créée par le gouvernement Jospin. Depuis sa disparition en mai 2011, ses missions, notamment concernant la déontologie dans le domaine de la police et de la sécurité, ont été confiées au Défenseur des droits. ↩