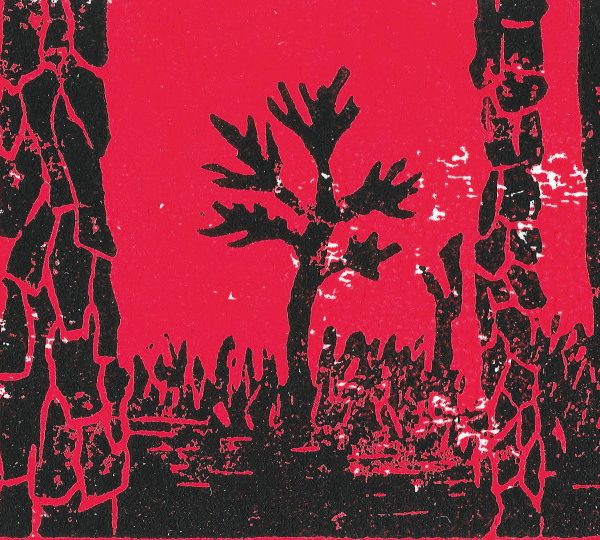Image de une : L. Dumont et M. Pastor.
Partout dans le monde, la pandémie de Covid-19 agit comme un puissant révélateur des inégalités sociales. Aux États-Unis, elle s’articule notamment à la crise du logement que connaît le pays depuis de nombreuses années: la spéculation immobilière, la gentrification et la flambée des loyers ont conduit à une explosion du nombre de sans-abris. La crise sanitaire et les pertes d’emploi qu’elle a entraînées ont mis de très nombreux⋅ses locataires dans l’impossibilité de payer leur loyer. Face à des mesures insuffisantes de la part des pouvoirs publics, les appels à la grève des loyers se sont multipliés, et les mobilisations autour des questions de logement ont nourri la dynamique existante des syndicats de locataires dans plusieurs grandes villes.
Entretien avec Rob Wohl, qui participe à la campagne Stomp Out Slumlords à Washington, et Julian Francis Park, membre du Tenant and Neighborhood Councils à Oakland, dans la baie de San Francisco.
Pouvez-vous présenter les organisations avec lesquelles vous travaillez ? Quelle place occupent les luttes autour du logement dans le mouvement social américain ?
Rob Wohl : À Washington, nous avons lancé Stomp Out Slumlords il y a trois ans. Après l’élection présidentielle de 2016, le groupe des socialistes démocrates (DSA, Democratic Socialists of America), qui n’était rien de plus qu’une petite « secte » à la gauche du Parti démocrate, s’est élargi et renouvelé. À ce moment-là, beaucoup de gens étaient à la recherche d’espaces pour militer : l’élection avait absorbé une grande partie de la vie politique américaine, puis a été suivie par une série de manifestations au moment de l’investiture de Trump. Toute cette énergie est retombée quand il est devenu évident que nous n’allions pas renverser le gouvernement, mais la campagne de Bernie Sanders avait mis de nombreuses personnes en mouvement.
Aujourd’hui, une très grande partie de la gauche américaine se penche sur les problèmes de logement, mais cela ne date pas de la pandémie. On ne peut pas échapper à cette question dans les grandes villes. Les loyers y sont extrêmement élevés et représentent une part toujours plus grande des revenus, ce qui fait que ce sujet se retrouve toujours connecté à d’autres, comme la santé ou la ségrégation urbaine…
Mais le logement est aussi un sujet fédérateur : il rassemble des personnes qui ne pensent pas avoir grand-chose en commun avant de s’apercevoir qu’elles rencontrent les mêmes problématiques. Si l’auto-organisation des locataires a récemment pris de l’ampleur aux États-Unis, c’est qu’il est de plus en plus difficile de vivre en ville dans des conditions décentes.
Ces vingt dernières années, les métropoles américaines ont connu d’importantes vagues de gentrification. Beaucoup de locataires ouvrier·ères ou issu·es des classes populaires ont été expulsé·es de leur logement, parfois plusieurs fois. Iels ont vu les prix grimper dans leur quartier ou ont senti qu’on les poussait dehors.
Julian Francis Park: Tenant and Neighborhood Councils (TANC) existe depuis trois ans. Les mobilisations de locataires sont très importantes en Californie. Cela peut s’expliquer de plusieurs manières. Tout d’abord, par le profil des habitant·es : aux États-Unis, l’État de New York et la Californie concentrent le plus grand nombre de locataires. La majorité des habitant·es y est propriétaire, mais bien moins que dans d’autres États : en Californie, c’est à peine 55 % de la population 1, alors que la moyenne nationale avoisine les 65 % 2.
Une autre explication se niche dans l’histoire même du capitalisme. Après le choc pétrolier de 1973, le système capitaliste se tourne vers la finance et la spéculation immobilière. Dans les villes où les locataires sont extrêmement nombreux·ses, et où l’investissement dans l’immobilier est le plus important, le coût du logement a rapidement augmenté, dans un contexte où les salaires, eux, stagnaient.
Les difficultés rencontrées par les locataires n’apparaissent cependant pas uniquement du fait de la gentrification. Elles résultent aussi de la détérioration parfois catastrophique des logements, notamment dans les régions industrielles en déclin. Tout cela appartient au même processus global, bien que l’attention se concentre le plus souvent sur la question de la gentrification, parce qu’elle concerne des grandes métropoles comme New York ou San Francisco.

Concrètement, comment travaillez-vous sur le terrain ?
R. W. : J’ai rejoint les DSA en 2017, avec l’intention de travailler en particulier sur des luttes locales. Sur les questions de logement, cela s’est rapidement révélé difficile. Nous avons d’abord essayé de prendre la mesure des risques d’expulsions dans la ville : en faisant des recherches juridiques, en allant aux audiences, et en rassemblant les documents nécessaires pour la défense des locataires qui se faisaient expulser de leur logement ou qui perdaient leur local commercial.
Nous avons ensuite cartographié ces adresses, nous sommes allé·es dans les boutiques et les appartements et nous avons informé les locataires de leurs droits. Dans un premier temps, c’était une sorte de campagne d’information. Puis, au cours des années, à force de trouver des personnes dans la même situation, un schéma s’est dégagé, avec des lieux dans lesquels les habitant·es rencontraient des problèmes similaires et étaient décidé·es à se battre.
Nous avons donc aidé les locataires à se rassembler, à faire circuler des pétitions ou à interpeller leurs représentant·es politiques. Ce n’est que plus récemment que nous nous sommes lancé·es dans l’organisation de grèves de loyers liées à des revendications ponctuelles.
J. F. P. : TANC a de plus en plus de membres. Il y a un an, nous avons réorganisé la structure de l’organisation en petits groupes de locataires et en essayant de se regrouper par quartiers, car les problématiques rencontrées d’un endroit à l’autre peuvent être très différentes.
Selon les périodes, nous sommes entre 30 et 60 membres, avec d’un côté un noyau dur, composé de personnes qui s’occupent de la gestion de l’association, et de l’autre des groupes de locataires avec qui on se mobilise. C’est une distinction un peu artificielle, mais qui différencie les modalités d’engagement. En ce moment, nous travaillons avec une vingtaine de groupes de locataires.
Nous avons aussi des petits groupes de locataires, qui rassemblent 7 ou 8 appartements par exemple, autour de problèmes de réparations non effectuées par les propriétaires, ou de harcèlement de la part de ces dernier·ères sur les locataires. Avec ces petits groupes nous avons réussi à obtenir gain de cause. C’était particulièrement encourageant car il s’agissait principalement de locataires hispanophones, alors que l’association est en grande majorité anglophone, – ce qui pose toujours des difficultés d’organisation, même si nous essayons d’améliorer nos compétences là-dessus, car les quartiers dans lesquels nous agissons sont multilingues.
La plupart du temps, nos actions sont donc plutôt des batailles à court ou moyen terme. Nous avons maintenant une certaine expérience de terrain et une présence en ligne relativement importante. C’est notamment dû au fait que certain⋅es militant·es de l’association sont proches du groupe communiste des DSA, et que nous avons des membres expert·es en communication. Cela nous donne une certaine visibilité.
Comme pour beaucoup d’autres collectifs engagés sur les questions de logement, notre stratégie est très proche de celle du syndicat de locataires de Los Angeles (LATU 3). Nous essayons de repérer les locataires qui rencontrent des problèmes, de les soutenir en organisant des assemblées de locataires, d’identifier leurs difficultés communes et d’élaborer des stratégies pour porter des revendications. Parfois, cela signifie que nous pouvons avoir recours à la grève. Il y en a eu plusieurs à Oakland récemment, mais c’est relativement nouveau pour nous.
Nous poussons un maximum à l’auto-organisation des locataires. Iels se réunissent et se mettent d’accord, puis informent directement leur propriétaire qu’iels ne paieront pas leur loyer. Généralement, le ou la propriétaire propose d’étaler les paiements, et refuse de négocier collectivement avec les locataires, tentent de les isoler en ne s’adressant à elles et eux qu’individuellement. Le rôle de TANC est de préserver l’organisation collective, et d’informer les locataires de leurs droits durant les assemblées.
Qu’est-ce qu’un syndicat de locataires ?
R. W. : On peut être tenté de comparer les syndicats de locataires avec les syndicats professionnels, mais c’est très différent. Les syndicats professionnels ont un pouvoir reconnu par la loi : les entreprises doivent en reconnaître l’existence et sont tenues, dans certaines circonstances, d’engager des négociations avec eux. Il n’existe rien de tel pour les locataires. Un syndicat de locataires n’a aucun pouvoir juridique, son seul rôle est de coordonner les locataires qui s’organisent pour un même objectif.
Il y aurait certainement un intérêt à inventer des cadres juridiques de négociation avec les propriétaires, mais aux États-Unis, il n’y en a pas eu depuis la Grande Dépression. J’ai milité avec des syndicats et j’ai pu voir à quel point la loi pouvait contraindre nos actions. Au contraire, nous avons dans les syndicats de locataires, en agissant en dehors de tout cadre légal, une certaine liberté et rien ne nous impose les manières de nous mobiliser. Je pense que c’est aussi pour cette raison qu’il y a eu une telle augmentation des mobilisations de locataires dans le pays ces dernières années. Dans le même temps, évidemment, les mobilisations autour du logement sont limitées par l’absence de ce cadre juridique. Nous essayons de tirer parti de cet entre-deux.
Ensuite, il n’existe pas de groupement institutionnalisé de locataires aux États-Unis. Cela signifie que l’on peut très bien être un petit groupe de militant·es sans ressources et créer une association qui permette de soutenir les locataires en difficulté et de leur donner des outils pour se défendre, sans devoir rivaliser avec de grosses associations institutionnelles, car les syndicats de locataires sont indépendants et présents dans quasiment toutes les grandes villes. À l’inverse, il est très difficile de démarrer un syndicat professionnel indépendant : il faut des ressources pour pouvoir négocier dans le cadre légal, et on se retrouve immédiatement face aux syndicats traditionnels les plus puissants.
La dernière différence avec les syndicats professionnels, c’est que les possibilités de se coordonner à l’échelle nationale sont faibles pour les locataires, car les situations sont trop différentes d’un État à l’autre, et aucune organisation n’est en mesure d’assurer cette coordination actuellement. Il y a une sorte d’éclatement de l’organisation des locataires et toutes les tentatives de se fédérer nationalement ont échoué pour l’instant.
En quoi cette grève de loyers est-elle différente des autres ?
R. W. : D’ordinaire, une grève de loyer signifie que vous avez les moyens de payer et que vous refusez de le faire pour obtenir quelque chose de la part de votre propriétaire : retirer l’humidité des murs, se débarrasser des rats, mettre fin à des frais de stationnement exorbitants, etc. C’est une tactique de négociation : le pouvoir des locataires vient du fait qu’iels peuvent cesser de payer dès lors qu’iels le décident. Le paiement du loyer devient un levier dans la négociation.
Aujourd’hui, dans cette période de pandémie, les propriétaires sont tout à fait conscient·es qu’une grande partie des locataires ne peut pas payer son loyer parce qu’iels n’ont plus de revenus. Iels essaient donc de leur faire signer des papiers pour échelonner ou retarder les paiements. Nous encourageons les locataires à ne rien signer de la sorte, à négocier collectivement et à refuser de payer quoi que ce soit en échange d’une potentielle réduction des loyers.
Dans certains cas, on essaie aussi d’encourager les personnes qui sont en capacité de payer à ne pas le faire par solidarité avec celles et ceux qui ont perdu leur emploi, pour que la pression économique soit plus forte envers les propriétaires.
Généralement, les locataires s’organisent par propriétaire, ou sur plusieurs propriétés quand c’est possible, afin d’augmenter la force de frappe de la grève. Cela ne signifie pas nécessairement que la mobilisation s’opère par quartier : certain·es gros·ses propriétaires possèdent des logements concentrés dans une seule partie de la ville, mais ce n’est pas très commun. En tant qu’organisation, nous sommes donc plutôt pragmatiques : nous essayons d’agir dans les endroits où l’on trouve des volontaires pour se mobiliser et faire passer le mot à leurs voisin·es.
En ce moment, notre capacité à faire du porte-à-porte ou à organiser des rencontres est évidemment amoindrie, on s’appuie donc aussi sur des réseaux préexistants, ou sur des locataires avec qui nous avons travaillé par le passé. Nous avons fait circuler une pétition en ligne qui concernait toute la ville de Washington, pour demander à la mairie de protéger les locataires. En ce moment, il y a aussi beaucoup d’immeubles dans lesquels des habitant·es nous ont appelé⋅es ou ont été envoyé⋅es vers nous, et où on essaie de s’organiser en partant de zéro. Cela fonctionne relativement bien : les gens se téléphonent, font circuler des tracts, etc.
Certain·es locataires viennent vers nous parce qu’iels connaissent nos revendications politiques pour l’annulation des loyers. Mais la plus grande partie nous contacte en expliquant simplement qu’iels ne peuvent pas payer. Notre travail est de transformer toutes ces situations individuelles en une lutte collective, et d’y injecter du contenu politique.

Y a-t-il des solutions proposées par le gouvernement ou les institutions actuellement ? Lesquelles ?
R. W. : En Virginie, les propriétaires n’ont pas le droit d’expulser les locataires pendant la période du confinement. L’autre solution proposée par des personnalités politiques ou la maire de Washington est de faire un chèque aux locataires. Cela peut soulager les personnes qui n’ont actuellement aucun revenu, bien entendu, mais nous pensons que ce n’est pas une vraie solution. Nous manquons encore de soutien politique pour aller au-delà de cela. Ces dernières semaines, des député·es ont proposé l’annulation des loyers au Congrès, mais iels font partie d’une toute petite minorité à gauche du Parti démocrate. Nous verrons si cela rencontre un écho. La pression politique pour résoudre les difficultés des locataires ne viendra que s’il y a une pression économique importante.
Certain·es propriétaires ont suspendu le loyer des grandes entreprises. La presse a ainsi parlé de chaînes comme H&M ou Adidas qui ont cessé de payer leur loyer. Mais ce n’est pas une action politique, c’est uniquement le résultat d’une négociation privée. Nous nous en servons comme point d’accroche pour convaincre les locataires : si ces grosses boîtes ne paient pas, pourquoi les locataires devraient-iels payer ?
J. F. P. : En Californie, il y a actuellement les dispositifs de trêve des expulsions parmi les plus efficaces du pays. Au départ, les décisions ne se prenaient qu’à l’échelle des villes, et une coordination à l’échelle de l’État semblait impossible. Elle a tout de même pu se faire dans certains comtés. Dans un premier temps, les municipalités de grandes villes comme San José ou San Francisco ont décidé qu’il était impossible de se faire expulser si l’on pouvait prouver qu’on était dans l’incapacité de payer son loyer à cause d’une perte de revenus due à la pandémie. Au même moment, le confinement a conduit les tribunaux à fermer et cela a empêché les autorités d’expulser des locataires à plusieurs endroits, notamment à Oakland puis dans tout le comté, qui inclut des villes importantes comme Berkeley et Alameda. Maintenant, il est tout simplement devenu impossible d’expulser des locataires qui peuvent démontrer qu’iels ne peuvent pas payer – et cela devrait se prolonger après la pandémie. C’est une victoire sur le plan juridique et politique, et une différence énorme avec les moratoires, qui ne font que repousser l’échéance du paiement et des expulsions. À l’échelle de l’État, les expulsions n’ont été que repoussées de trois mois après l’urgence sanitaire. TANC n’a pas directement pris part à ces négociations, mais nous travaillons avec des groupes qui interviennent sur le plan législatif et interpellent les politicien·nes, et nous relayons leurs initiatives.
Comme actuellement les expulsions sont empêchées, et probablement pour longtemps dans certains comtés, la grève de loyers semble une tactique assez peu risquée. Pour l’instant, nous n’avons pas mis en place de caisse de grève, mais cela va se révéler nécessaire lorsque la grève sera vraiment active, et si les expulsions reprennent.
Quel est l’état de la mobilisation actuellement, et comment la mettre en perspective par rapport à des luttes plus anciennes ?
R. W. : J’ai été très surpris de constater l’étendue des mobilisations de locataires en ce moment. Stomp Out Slumlords est en contact avec plus d’une vingtaine d’immeubles dans l’ensemble de la ville, où les locataires s’organisent et portent des revendications. Nous sommes également actif·ves au sein d’une fédération de syndicats de locataires de Washington. Cette coalition a fait tout le travail de lien avec les autorités de la ville, et nous essayons de les pousser à agir de manière plus directe, en demandant l’annulation des loyers par exemple.
La crise actuelle bouleverse les habitudes et les opinions des gens, elle ouvre des possibilités de se mobiliser à une échelle plus grande que d’ordinaire. C’est un sentiment que partagent beaucoup de militant·es et de responsables associatif·ves en ce moment. Personnellement, je m’étais engagé dans différentes luttes après la crise de 2008, et en particulier autour du scandale des saisies immobilières de 2010-2011. Il s’agissait alors de combattre les expulsions, mais nous luttions principalement contre des banques. C’était donc très difficile de trouver des solutions politiques. Nous avons remporté quelques victoires et beaucoup appris avec cette mobilisation, mais nous avons échoué à construire un mouvement solide contre les expulsions, et ce même dans un contexte où des millions de personnes avaient perdu leur logement. C’est très lié à un manque d’habitude de mobilisation, mais pas uniquement. Les locataires ne se sentaient pas autorisé·es à porter des revendications, ou peinaient à voir qu’elles résultaient d’une crise systémique.
Aujourd’hui, j’ai l’impression que les gens sont beaucoup plus affecté·es et prêt·es à se battre. Nous sommes limité·es par le petit nombre de membres de notre association, mais je suis optimiste car la crise économique est tellement profonde que les travailleur·euses, les locataires et les précaires semblent prêt·es à lutter pour se défendre.
J. F. P. : Les associations et les collectifs habituellement mobilisés sur les questions de logement sont très actifs en ce moment, et rassemblent de plus en plus de membres. Un mouvement assez massif semble se construire : beaucoup de locataires ne peuvent pas payer, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui refusent de payer par solidarité. Il y a également un certain nombre de campements de sans-abri qui sont politisés et actifs 4. Les réseaux d’entraide grossissent beaucoup. Comme après les incendies de Camp Fire en 2018, des associations distribuent des masques et organisent des distributions de nourriture. Il est intéressant de voir que ces différentes mobilisations et ces réseaux s’imbriquent de plus en plus souvent : les discussions autour des luttes de locataires sont quasi systématiquement associées à la mise en place de réseaux d’entraide.
Quels types de logements et de quartiers sont concernés par ces mobilisations ?
R. W. : Nous travaillons beaucoup dans des quartiers en cours de gentrification, qui sont de plus en plus chers et se développent de telle manière que beaucoup de leurs habitant·es en sont progressivement exclu·es. Mais une bonne partie de notre action se déroule aussi dans des quartiers où il n’y a aucune menace de « redéveloppement », simplement parce qu’ils sont complètement laissés à l’abandon. Les habitant·es y sont pauvres et les logements insalubres. Ce sont principalement des travailleur·euses immigré·es, qui ont des emplois précaires dans le secteur des services. Les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie sont très inégales d’un quartier à un autre.
On parle beaucoup de la gentrification et de ses conséquences. C’est effectivement un énorme problème, mais il est complexe. Jusqu’à une période récente, le modèle urbain des grandes villes américaines était calqué sur un schéma inverse de celui des villes européennes. Les classes populaires vivaient la plupart du temps dans les centre-villes, où les petits appartements abritaient une grande pauvreté. Les classes moyennes et supérieures vivaient quant à elles dans des quartiers résidentiels éloignés des centres urbains, les suburbs. La gentrification des centre-villes a partiellement inversé ce processus en repoussant les populations les plus vulnérables très loin du cœur des activités commerciales et administratives de la ville, et renforcé leur isolement et leur pauvreté.
Je travaille en ce moment avec un immeuble loin du centre-ville de Washington. C’est un complexe immobilier énorme, avec plus de deux mille appartements. Au mois de février, les locataires ont organisé une gigantesque grève de loyers, qui a fonctionné parce qu’un grand nombre de locataires travaillait dans la restauration et se connaissait par ce biais. Certain·es avaient même déjà fait partie ensemble de syndicats professionnels.
Avec cette crise, c’est la première fois que je suis amené à travailler autant avec des locataires qui vivent aussi éloigné·es du centre-ville, dans de très grosses banlieues populaires. Cela signifie très clairement que nous devons élargir notre périmètre d’action.

Qui sont les locataires mobilisé·es ?
R. W. : Les femmes sont très présentes dans les luttes de locataires. C’est un fait ancré historiquement : toute la documentation sur la grande vague de grèves de loyers autour de la Première Guerre mondiale montre que les femmes étaient en première ligne. Aux États-Unis, l’International Ladies Garment Workers Union 5, un syndicat d’ouvrier·ères textiles, était très actif dans les grèves de loyer. Les femmes ont également joué un rôle prépondérant au sein des organisations socialistes européennes qui avaient mené de grandes grèves de loyers, notamment à Glasgow en Écosse, de même que pour les grèves des années 1960 et 1970, en particulier à Washington et à Philadelphie.
D’une certaine manière, cela reflète la division sociale et sexuelle du travail : les femmes sont assignées au travail domestique, à la garde des enfants, et sont amenées à se mobiliser sur ces causes. La grève des loyers, de ce point de vue, est aussi une contestation des normes de genre. Comme pendant toutes les crises, les femmes se mobilisent, notamment sur les actions de terrain, même si elles sont moins visibles ou reçoivent moins d’attention que les leaders politiques ou syndicaux, qui sont le plus souvent des hommes.
De manière générale, les grèves de loyers rassemblent surtout les personnes qui ont le moins de ressources dans la lutte des classes : des travailleur·euses immigré·es, des mères célibataires, des précaires et des personnes sans-papiers.
J. F. P. : Les femmes sont effectivement très présentes et actives dans les assemblées de locataires, mais cela ne signifie pas qu’elles y ont plus de responsabilités, car les mécanismes de domination se reproduisent à la fois dans le foyer et dans les assemblées.
Comment se mobiliser dans des contextes de confinement ou avec des règles de distanciation physique strictes ? Certains groupes ont organisé des manifestations en voiture ou en maintenant une distance entre les personnes, d’autres des actions virtuelles et des mobilisations sous forme de hashtags…
J. F. P. : Le confinement nous a poussé à être inventif·ves. La situation catastrophique nous a obligé à dépasser les contraintes matérielles et l’impossibilité de se voir réellement.
À l’échelle d’un immeuble, presque plus personne ne fait de porte-à-porte pour convaincre ses voisin·es. En revanche, les locataires écrivent des petits mots qu’iels se glissent sous la porte, ou accrochent des pancartes à leur fenêtre en expliquant qu’iels ne peuvent plus payer leur loyer ou qu’iels ont besoin d’aide, tout en invitant à les contacter. À cette petite échelle, les gens semblent généralement trouver le moyen de communiquer. Et pour construire une grève de loyers, il faut commencer par se parler et construire un réseau de personnes. C’est ce que font les groupes de locataires en utilisant des applications ou des réseaux sociaux lorsqu’iels le peuvent. Le premier contact est le plus difficile. C’est aussi pour cette raison que lorsque des locataires mettent à profit leurs réseaux professionnels, communiquent avec des collègues qui sont dans la même situation, cela fonctionne particulièrement bien.
R. W. : La pandémie, le confinement et la distanciation physique nous ont enlevé des possibilités d’action que l’on a tendance à considérer comme des rituels indispensables à toute mobilisation. Mais ces choses ne sont peut-être pas si nécessaires que cela pour remporter des victoires. On pense toujours qu’il faut faire des manifestations dans l’espace public, des meetings, des actions directes, du porte-à-porte pour convaincre des inconnu·es et les amener dans nos luttes. Mais quand on observe les luttes de travailleur·euses ou de locataires qui ont réussi, on ne peut pas nier que la mobilisation repose souvent en grande partie sur des personnes engagées qui ont convaincu leur entourage – leurs collègues, leurs ami·es, leurs voisin·es, les membres de leurs famille, etc. – de rejoindre la mobilisation, sur la base d’une relation de confiance et d’un objectif partagé.
Ensuite, l’utilisation des leviers économiques est capitale. L’arme la plus puissante des locataires, c’est de ne pas payer leur loyer. Et cela, iels peuvent le faire même dans un contexte de confinement généralisé. Les individus possèdent un pouvoir de classe selon leur position sociale. Les locataires, par conséquent, ont une relation collective à leur propriétaire : iels en sont dépendant·es pour se loger, et le ou la propriétaire est dépendant·e de leur loyer. La manière la plus efficace de perturber le fonctionnement de cette relation pour porter des revendications est de capitaliser sur leur capacité à garder pour eux leur loyer et à résister à l’expulsion.
- Voir par exemple « California’s Low Homeownership Rate to Continue », First Tuesday, mars 2020, disponible sur <journal.firsttuesday.us>. ↩
- Voir « Homeownership Rate in the United States from 1990 to 2019 », <statistica.com>, mars 2020. ↩
- Voir Tracy Jeanne Rosenthal, « “Il n’y a pas de crise du logement” », disponible sur <jefklak.org>. ↩
- Lire à ce sujet Julian Francis Park, « Pour une grève permanente des loyers », disponible sur <jefklak.org>. ↩
- Le syndicat des ouvrier·ères de vêtements pour dames, à travers les actions de la syndicaliste Pauline Newman et du groupe de militantes qu’elle avait créé en son sein, a joué un rôle central dans une des plus grandes grèves de loyers des États-Unis, à New York en 1908. Celle-ci a mené aux premières lois de régulation du prix des loyers dans la ville. ↩